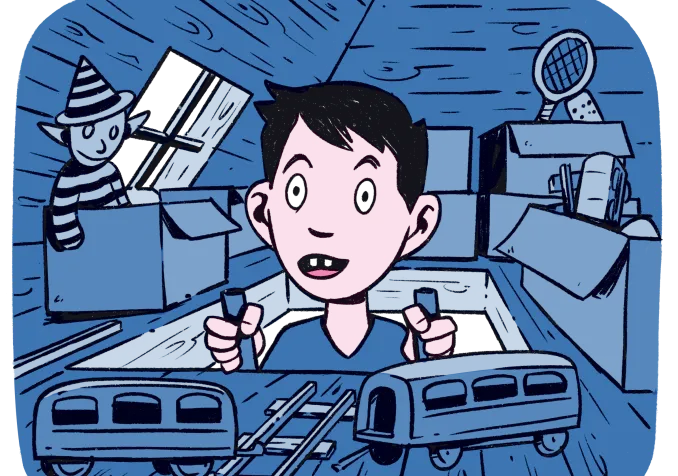SE RELIER SANS ÉCRAN
Le jeu en phase d'être reconnu comme industrie culturelle
ÉVOLUTION Comme les livres ou les films, les jeux arborent désormais sur leurs boîtes les noms de leurs concepteurs et illustrateurs. Selim Krichane, directeur du Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz (VD), évoque plusieurs périodes charnières: «Il y a eu un tournant d’industrialisation de la fabrication des jeux au XIXe siècle, puis un phénomène d’édition où l’on quitte un modèle de jeux relativement standards, longs dans la durée, ou de matériel de jeu qui peut être utilisé pour plusieurs jeux différents, comme les jeux de cartes. Et on va vers des jeux qui sont édités par des fabricants, des éditeurs, avec un matériel qui est réservé à un jeu spécifique.» «Entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, on voit une explosion de la production, avec une diversification des éditeurs, des créateurs et une sorte d’accroissement assez spectaculaire du volume de jeux produits par année», complète le spécialiste. Que l’on parle de jeu vidéo ou de jeu d’édition, la pratique augmente fortement depuis les années 2010. «Et elle s’est transformée. D’une série de grands classiques dans les années 1970-80, où l’on jouait plus ou moins tous aux mêmes jeux que l’on avait dans les armoires familiales, on a passé à un domaine qui s’est fortement diversifié.»
«La reconnaissance des auteurs se joue plus ou moins en parallèle. Avec un paradoxe: le jeu de société est plus ancien historiquement, mais a plus de peine à asseoir sa légitimité culturelle que le jeu vidéo, qui a fait son entrée dans les musées dès les années 2010 et qui bénéficie de nombreuses aides publiques à la création», pointe le chercheur.
«Cette légitimité a été difficile à acquérir. Pour les Églises, le jeu a longtemps été source de méfiance. Aujourd’hui, les jeux nous parlent de notre monde, de la crise climatique… comme tous les objets culturels.» Pour preuve, le Musée suisse du jeu accueille jusqu’en mars prochain une exposition qui explore les liens entre le jeu, la nature et les défis environnementaux contemporains. J. B.