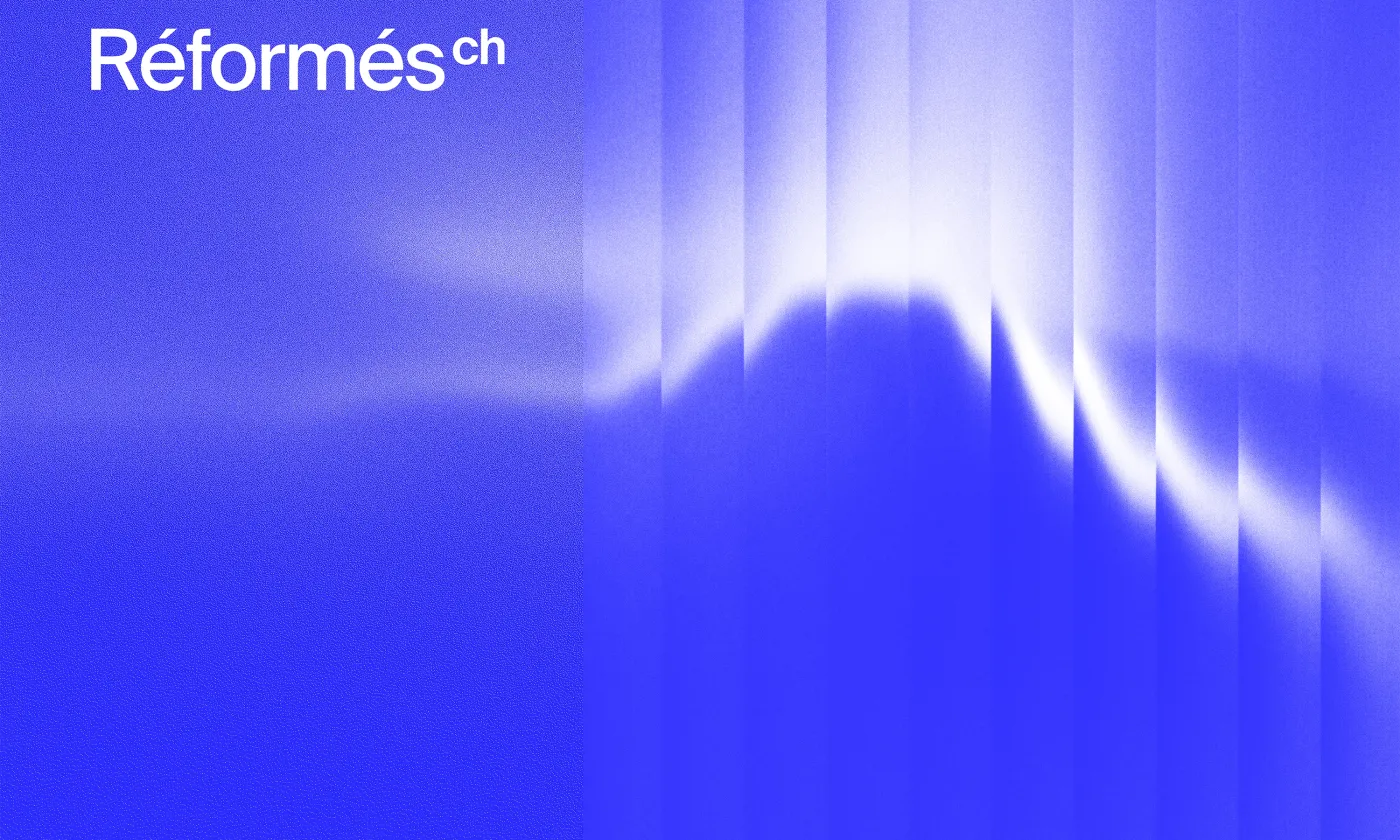
i
[pas de légende]
La mort sociale inquièterait bien plus que la fin biologique: Des chercheurs lausannois analysent les comportements actuels sur la santé, la famille et le travail
Vendredi et samedi, un nombreux auditoire est venu assister à un colloque présentant les premières conclusions de quatre ans d’investigations en sciences humaines et sociales
Deux exemples parmi les douze projets de recherche interuniversitaire balayant un large spectre de connaissances, de la psychologie sociale à la médecine en passant par l’éthique ou l’écologie. En 2001, les Universités de Lausanne (UNIL) et Genève en partenariat avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) lancent « Science, Vie, Société », l’un des plus ambitieux programme de collaboration académique. Regroupées sous l’appellation Iris (Intégration, Régulation et Innovation Sociales) ces douze investigations visent au « renforcement des sciences humaines et sociales sur l’arc lémanique » et balisent un large spectre de connaissance : écologie, éthique, psychologie sociale, médecine. « Famille, maladie, vieillesse, mort : les thèmes abordés par les chercheurs touchent chacun de nous. Après quatre ans, nous nous sommes dits qu’il serait intéressant de présenter un état des lieux au grand public », explique l’adjointe au rectorat de l’UNIL et coordinatrice du colloque Sylvie Dreyfus.
Les 23 et 24 septembre à Dorigny, plusieurs centaines de personnes sont donc venues écouter douze présentations des travaux interuniversitaires menés par une cinquantaine de doctorants ou professeurs. Paru en même temps aux éditions de l’Hèbe, un ouvrage* reprend l’essentiel de cette série de « regards sur la santé, la famille et le travail ». La peur de n'être plus rienDoctorant en psychologie sociale, Cédric Gumy renverse la théorie classique dite de la « gestion de la peur » - qui, grosso modo, explique la naissance des idéologies et des croyances culturelles par la crainte de voir s’évanouir son corps – en postulant que la « mort sociale effraie bien davantage que la disparition physique. « L’angoisse de n’être plus rien prendrait le pas sur celle de la fin biologique ». Selon le jeune chercheur, ce ne serait donc pas le biologique qui amènerait le social, mais l’inverse. L’enjeu résiderait alors dans la question de l’intégration sociale, et la vraie question deviendrait : être ou ne pas être oublié des autres.
Autre recherche présentée, celle d’Ilario Rossi. Le Lausannois réfléchit à la toute puissance actuelle de la médecine sur nos vies et nos représentations. Médicalisation de la vie, préoccupation grandissante envers la santé, tout se passe comme si cette dernière se voyait « élevée au rang d’idéal suprême, de morale unanime, dans une société où les dynamiques d’élaboration du rapport à soi, aux autres et au monde se construisaient de plus en plus dans l’appréhension du corps ». La médecine comme paradigme suprême ?Connaissance de plus en plus approfondie de la génétique et de la biochimie du corps, capacité d’intervention sans cesse accrue - à travers la transplantation d’organes, le clonage ou les cellules souches – et « surinvestissement matériel et symbolique » du médicament : pour Ilario Rossi, la médecine légitime son pouvoir grandissant « pour s’opposer à cet autre pouvoir que sont la souffrance, la maladie et la mort ». Tout se passe comme si la médicalisation croissante répondait par une demande sociale qui délègue chaque jour davantage aux compétences médicales « la prise en compte des problèmes sociaux et la souffrance sociale qu’elle induit ».
A Lausanne, explique encore le conférencier, les réflexions en cours dans le domaine de l’anthropologie de la santé portent entre autres sur la « crise des religions ». La quête de santé s’accompagne en effet d’une quête de sens, d’un besoin de spiritualité. Devenue entièrement laïque, la médecine « dissocie artificiellement l’âme du corps », partant de l’idée que « maladie et mort constituent les sources communes de la médecine et de la religion ». De toutes les façons, conclut l’intervenant, « la médecine doit réinvestir le social », revaloriser l’expérience subjective et ne pas faire l’impasse sur le dialogue avec les sciences sociales pour comprendre comment elle peut « faire société ». UTILE*« Eloge de l’altérité, 12 regards sur la santé, la famille et le travail », éd. de L’Hèbe
Les 23 et 24 septembre à Dorigny, plusieurs centaines de personnes sont donc venues écouter douze présentations des travaux interuniversitaires menés par une cinquantaine de doctorants ou professeurs. Paru en même temps aux éditions de l’Hèbe, un ouvrage* reprend l’essentiel de cette série de « regards sur la santé, la famille et le travail ». La peur de n'être plus rienDoctorant en psychologie sociale, Cédric Gumy renverse la théorie classique dite de la « gestion de la peur » - qui, grosso modo, explique la naissance des idéologies et des croyances culturelles par la crainte de voir s’évanouir son corps – en postulant que la « mort sociale effraie bien davantage que la disparition physique. « L’angoisse de n’être plus rien prendrait le pas sur celle de la fin biologique ». Selon le jeune chercheur, ce ne serait donc pas le biologique qui amènerait le social, mais l’inverse. L’enjeu résiderait alors dans la question de l’intégration sociale, et la vraie question deviendrait : être ou ne pas être oublié des autres.
Autre recherche présentée, celle d’Ilario Rossi. Le Lausannois réfléchit à la toute puissance actuelle de la médecine sur nos vies et nos représentations. Médicalisation de la vie, préoccupation grandissante envers la santé, tout se passe comme si cette dernière se voyait « élevée au rang d’idéal suprême, de morale unanime, dans une société où les dynamiques d’élaboration du rapport à soi, aux autres et au monde se construisaient de plus en plus dans l’appréhension du corps ». La médecine comme paradigme suprême ?Connaissance de plus en plus approfondie de la génétique et de la biochimie du corps, capacité d’intervention sans cesse accrue - à travers la transplantation d’organes, le clonage ou les cellules souches – et « surinvestissement matériel et symbolique » du médicament : pour Ilario Rossi, la médecine légitime son pouvoir grandissant « pour s’opposer à cet autre pouvoir que sont la souffrance, la maladie et la mort ». Tout se passe comme si la médicalisation croissante répondait par une demande sociale qui délègue chaque jour davantage aux compétences médicales « la prise en compte des problèmes sociaux et la souffrance sociale qu’elle induit ».
A Lausanne, explique encore le conférencier, les réflexions en cours dans le domaine de l’anthropologie de la santé portent entre autres sur la « crise des religions ». La quête de santé s’accompagne en effet d’une quête de sens, d’un besoin de spiritualité. Devenue entièrement laïque, la médecine « dissocie artificiellement l’âme du corps », partant de l’idée que « maladie et mort constituent les sources communes de la médecine et de la religion ». De toutes les façons, conclut l’intervenant, « la médecine doit réinvestir le social », revaloriser l’expérience subjective et ne pas faire l’impasse sur le dialogue avec les sciences sociales pour comprendre comment elle peut « faire société ». UTILE*« Eloge de l’altérité, 12 regards sur la santé, la famille et le travail », éd. de L’Hèbe











