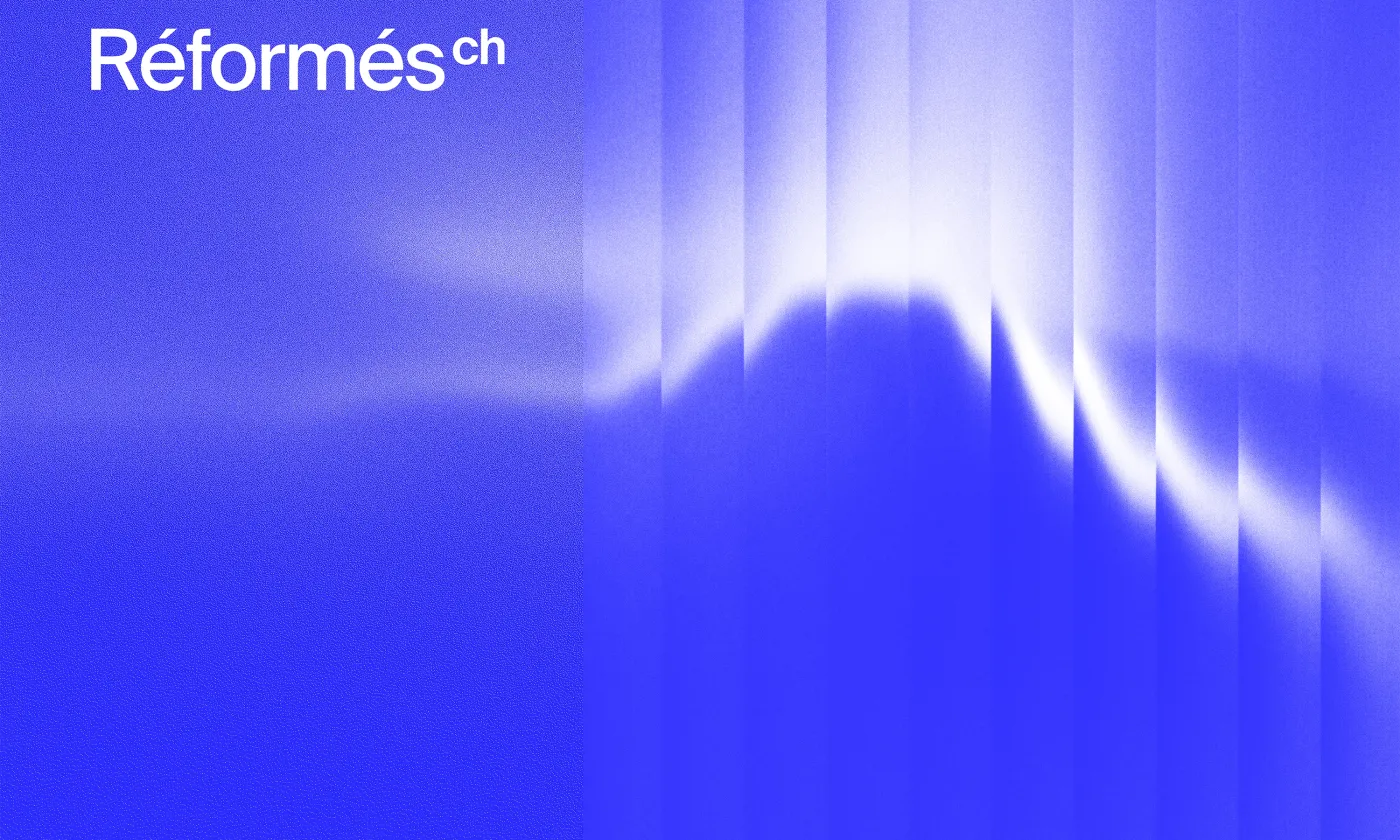
i
[pas de légende]
«Le cœur de la vie religieuse est dans l’action »
Dès jeudi, l’université de Genève organise un colloque international sur Bergson et la religion
Un philosophe à redécouvrir au moment où l’Abbé Pierre ou Sœur Emmanuelle illustrent l’attitude de don commandée par la « morale ouverte ».Redécouvrir la réflexion du philosophe Henri Bergson (1859-1941) sur la religion « répond à une préoccupation de notre époque », estime Ghislain Waterlot. Il a mis sur pied le colloque « Bergson et la religion » organisé par la Faculté autonome de théologie protestante de Genève, du 30 novembre au 1er décembre prochains. « Le dernier ouvrage majeur du philosophe, « Les deux sources de la morale et de la religion », a été réimprimé plus de trois cents fois. Cet auteur a été un peu oublié pendant la guerre, et on le redécouvre depuis une quinzaine d’années », poursuit le philosophe de l’université de Genève. Les personnalités, telles l’Abbé Pierre ou Sœur Emmanuelle, qui suscitent l’enthousiasme des foules « font comprendre que le cœur de la vie religieuse est dans l’action, qu’il s’agisse d’une action sociale envers les exilés ou les étrangers, ou de la création d’une communauté religieuse qui accueille tant de jeunes, comme Taizé ».
Bergson interroge en philosophe l’expérience religieuse et, conformément à son rejet de l’intellect au profit de l’intuition, affirme que « les mystiques chrétiens, Thérèse d’Avila, François d’Assise, Catherine de Sienne ont une expérience de la rencontre avec Dieu qui est la meilleure voie de connaissance ». Il distingue entre « morale close », caractérisée par le souci de préserver son groupe, qui fait se dresser une tribu contre les autres tribus et se battre contre tous ceux qui sont extérieurs, et « morale ouverte », attitude de don et d’ouverture permettant à tous les hommes de se retrouver dans la fraternité. « Les mystiques peuvent faire comprendre aux hommes qu’ils sont faits pour autre chose que se reproduire de génération en génération en protégeant leur niche. Notre vie peut être une création et un don, un risque à courir. Très concrètement, il s’agit de créer des formes plus humaines de relation à autrui ».
C’est pourquoi « l’intérêt de Bergson s’est porté sur le mysticisme chrétien qui est dans l’action, plutôt que sur les mystiques antiques ou bouddhistes », poursuit Ghislain Waterlot. Paradoxe : Bergson a méconnu l’aspect mystique de la foi protestante, se rapprochant du catholicisme alors que Rome avait mis ses œuvres à l’index. « Au fond, Dieu n’attend qu’une chose : le désir d’aimer et d’être aimé est le secret de la création. D’où l’intérêt de figures comme l’Abbé Pierre ou Sœur Emmanuelle : elles permettent de témoigner de l’amour de Dieu qui est au fond des hommes. Pour Bergson, le plus important, c’est l’action visant à témoigner de cet amour de Dieu ». Le colloque « a pour but de comprendre quelle était la double origine de la religion pour Bergson : l’origine naturelle, qui est de nous rassurer et de nous conforter, et, à un autre niveau, l’effort que les mystiques ont produit pour retrouver le mouvement premier, qui est l’action créatrice de Dieu ».Utile: « Bergson et la religion », nouvelles perspectives sur Les deux sources de la morale et de la religion, colloque international du 30 novembre et 1er décembre 2006, Centre universitaire protestant, 2 av. du Mail, Genève
Bergson interroge en philosophe l’expérience religieuse et, conformément à son rejet de l’intellect au profit de l’intuition, affirme que « les mystiques chrétiens, Thérèse d’Avila, François d’Assise, Catherine de Sienne ont une expérience de la rencontre avec Dieu qui est la meilleure voie de connaissance ». Il distingue entre « morale close », caractérisée par le souci de préserver son groupe, qui fait se dresser une tribu contre les autres tribus et se battre contre tous ceux qui sont extérieurs, et « morale ouverte », attitude de don et d’ouverture permettant à tous les hommes de se retrouver dans la fraternité. « Les mystiques peuvent faire comprendre aux hommes qu’ils sont faits pour autre chose que se reproduire de génération en génération en protégeant leur niche. Notre vie peut être une création et un don, un risque à courir. Très concrètement, il s’agit de créer des formes plus humaines de relation à autrui ».
C’est pourquoi « l’intérêt de Bergson s’est porté sur le mysticisme chrétien qui est dans l’action, plutôt que sur les mystiques antiques ou bouddhistes », poursuit Ghislain Waterlot. Paradoxe : Bergson a méconnu l’aspect mystique de la foi protestante, se rapprochant du catholicisme alors que Rome avait mis ses œuvres à l’index. « Au fond, Dieu n’attend qu’une chose : le désir d’aimer et d’être aimé est le secret de la création. D’où l’intérêt de figures comme l’Abbé Pierre ou Sœur Emmanuelle : elles permettent de témoigner de l’amour de Dieu qui est au fond des hommes. Pour Bergson, le plus important, c’est l’action visant à témoigner de cet amour de Dieu ». Le colloque « a pour but de comprendre quelle était la double origine de la religion pour Bergson : l’origine naturelle, qui est de nous rassurer et de nous conforter, et, à un autre niveau, l’effort que les mystiques ont produit pour retrouver le mouvement premier, qui est l’action créatrice de Dieu ».Utile: « Bergson et la religion », nouvelles perspectives sur Les deux sources de la morale et de la religion, colloque international du 30 novembre et 1er décembre 2006, Centre universitaire protestant, 2 av. du Mail, Genève











