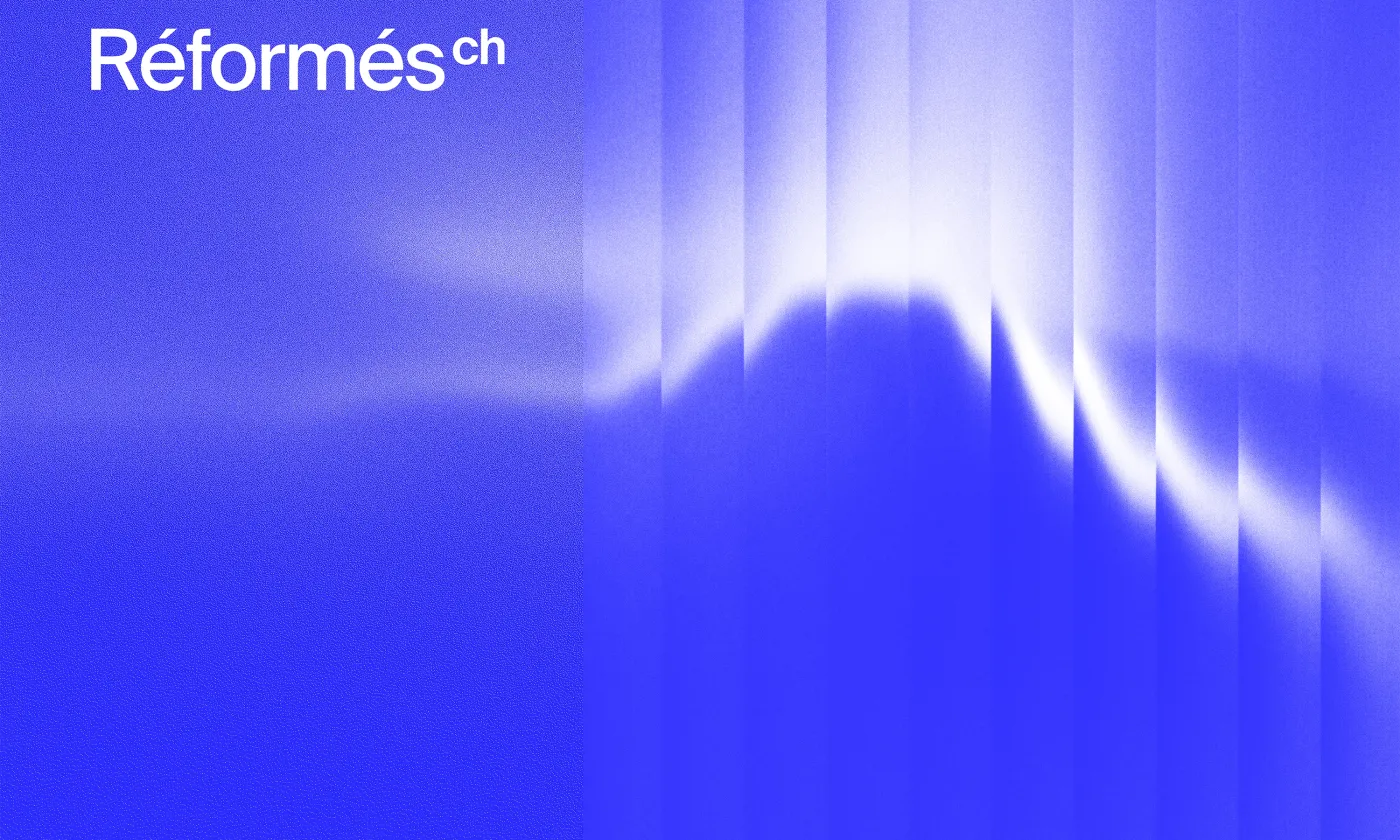
i
[pas de légende]
Samuel Lutz, le départ d’une conscience politique
Qu’il s’agisse des enfants, des étrangers, des familles démunies, des handicapés : Samuel Lutz s’engage et le Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure donne de la voix
Portrait d’un homme sensible qui aura fait bouger son Eglise.Il s’agit très certainement, parmi les Eglises romandes, d’un des Conseillers synodaux les plus réactifs politiquement. Qu’il s’agisse de l’adoption de la nouvelle loi fédérale sur les allocations familiales, des nouvelles lois sur l’asile et les étrangers, de l’aide aux pays de l’Est, dès qu’un thème sensible est discuté sur la scène fédérale, Samuel Lutz, président du Conseil synodal (exécutif) à la tête des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, s’engage et donne de la voix. Attentif à la misère sociale, aux besoins des familles pauvres pour que les enfants d’aujourd’hui ne soient pas les déshérités de demain, de ceux qui ont perdu leur travail, des étrangers vivant en marge de la société, mais aussi des plus faibles et des sans-voix tels les handicapés mentaux adultes ou les sourds, il quittera son poste en septembre prochain. « Je ne pouvais terminer la législature, pour raison d’âge», explique ce pasteur de 63 ans, « j’ai choisi le bon moment ».
« Tout le monde me demande ce que je vais faire de ma retraite, à l’automne », commente-t-il depuis son bureau bernois décoré de photographies de la nature. « Et je réponds : je ne sais pas. L’Université ne m’a pas fait de proposition. » On sent comme un regret chez ce docteur en théologie qui était, lors de son élection en novembre 1995, considéré comme un « penseur » et un « théoricien ». Samuel Lutz a surpris son monde en incarnant la conscience politique de l’Eglise, et s’est révélé un communicateur hors pair. Réélu au Synode (législatif) de novembre 2006 « avec un score qui rappelle les meilleurs scores de l’ère soviétique, 180 voix sur 180 votants », il ne voulait pas démissionner tout de suite. « Dès lors, la question était juste de trouver le moment favorable. Au Synode d’été, fin mai, j’évaluerai le programme de législature 2004-2007. L’élection de la personne qui me succédera aura lieu le 29 mai ». Si tout membre de l’Eglise pourvu du droit de vote peut en théorie être élu, la bataille de succession a déjà commencé. Au sein du Conseil synodal, les noms de Pia Grossholz-Fahrni, sa nouvelle vice-présidente, et du pasteur de Münsingen, Andreas Zeller, sont annoncés parmi les candidats potentiels. Le 13 février, les présidents de fractions, chargés de présenter des papables, se réuniront.
« Ma compréhension de la mission de l’Eglise, c’est d’être présent dans le monde ; tout ce qui concerne l’actualité politique concerne l’Eglise, et vice-versa. Il faut que ce que nous proposons ne le soit pas « post festum » (après la fête, ndlr), mais durant la discussion publique », répond Samuel Lutz à la question de son engagement dans le débat national. « Bien sûr, il y a toujours des gens qui se sentent provoqués parce qu’ils ont une autre opinion : l’asile est un thème controversé, tout comme celui de l’intégration des musulmans. Le risque existe que d’autres – l’UDC, l’extrême-droite – s’emparent de ces thèmes et en abusent dans leurs propres intérêts. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas en parler. Il faut être ouvert, participer à la recherche de solutions et ne pas avoir peur. Les thèmes politiques ne sont d’ailleurs pas toujours les plus chauds ; ce sont parfois les thèmes religieux qui vous brûlent les mains. » Un exemple ? « L’homosexualité dans l’Eglise. C’était une question à traiter et je suis heureux que nous l’ayons fait. Pour certains, ne pas limiter la bénédiction aux couples acceptés, mais l’ouvrir à tous était une question essentielle de leur compréhension de l’Evangile. L’Eglise a mûri en acceptant qu’il y ait une pluralité de points de vue, parmi ses rangs, tout comme il existe une pluralité de relations dans le monde extérieur. Ce débat fait du bien parce qu’il vous ouvre. Bien sûr, il ne s’agit pas de tolérer tout et n’importe quoi : un fondamentalisme qui condamne les autres n’est pas acceptable ». Difficile de croire, en entendant ces paroles libérales, que Samuel Lutz ait été élevé dans un milieu piétiste et que son père ait présidé l’Alliance évangélique suisse.
Les thèmes de débat dans l’Eglise, « nous les trouvons simplement en étant attentifs à ce qui nous entoure. Nous apparaissons toujours comme une Eglise excentrée, mais il existe aussi des situations de pauvreté en ville de Berne, par exemple à Berne-ouest qui compte beaucoup de résidents étrangers et d’enfants. Or, en périphérie, la poste ferme, bientôt l’école et le pasteur doit réduire son temps de travail. Ce n’est pas le rôle de l’Eglise de proposer un programme, mais il faut aussi savoir aller trouver le gouvernement cantonal quand les choses ne vont plus ».
Le personnage a plusieurs facettes. Sa mère était d’origine huguenote, d’où peut-être son intérêt de chercheur pour l’histoire de la Réforme, qu’il a dû abandonner durant ses années de Conseil synodal (de 1988 à 1993, puis dès 1996 comme président à plein temps). « Je vais apprendre une nouvelle manière de vivre, retravailler mon piano, rencontrer d’autres gens », se réjouit celui qui avoue n’avoir jusqu’alors« rien fait d’autre que travailler ».
« Tout le monde me demande ce que je vais faire de ma retraite, à l’automne », commente-t-il depuis son bureau bernois décoré de photographies de la nature. « Et je réponds : je ne sais pas. L’Université ne m’a pas fait de proposition. » On sent comme un regret chez ce docteur en théologie qui était, lors de son élection en novembre 1995, considéré comme un « penseur » et un « théoricien ». Samuel Lutz a surpris son monde en incarnant la conscience politique de l’Eglise, et s’est révélé un communicateur hors pair. Réélu au Synode (législatif) de novembre 2006 « avec un score qui rappelle les meilleurs scores de l’ère soviétique, 180 voix sur 180 votants », il ne voulait pas démissionner tout de suite. « Dès lors, la question était juste de trouver le moment favorable. Au Synode d’été, fin mai, j’évaluerai le programme de législature 2004-2007. L’élection de la personne qui me succédera aura lieu le 29 mai ». Si tout membre de l’Eglise pourvu du droit de vote peut en théorie être élu, la bataille de succession a déjà commencé. Au sein du Conseil synodal, les noms de Pia Grossholz-Fahrni, sa nouvelle vice-présidente, et du pasteur de Münsingen, Andreas Zeller, sont annoncés parmi les candidats potentiels. Le 13 février, les présidents de fractions, chargés de présenter des papables, se réuniront.
« Ma compréhension de la mission de l’Eglise, c’est d’être présent dans le monde ; tout ce qui concerne l’actualité politique concerne l’Eglise, et vice-versa. Il faut que ce que nous proposons ne le soit pas « post festum » (après la fête, ndlr), mais durant la discussion publique », répond Samuel Lutz à la question de son engagement dans le débat national. « Bien sûr, il y a toujours des gens qui se sentent provoqués parce qu’ils ont une autre opinion : l’asile est un thème controversé, tout comme celui de l’intégration des musulmans. Le risque existe que d’autres – l’UDC, l’extrême-droite – s’emparent de ces thèmes et en abusent dans leurs propres intérêts. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas en parler. Il faut être ouvert, participer à la recherche de solutions et ne pas avoir peur. Les thèmes politiques ne sont d’ailleurs pas toujours les plus chauds ; ce sont parfois les thèmes religieux qui vous brûlent les mains. » Un exemple ? « L’homosexualité dans l’Eglise. C’était une question à traiter et je suis heureux que nous l’ayons fait. Pour certains, ne pas limiter la bénédiction aux couples acceptés, mais l’ouvrir à tous était une question essentielle de leur compréhension de l’Evangile. L’Eglise a mûri en acceptant qu’il y ait une pluralité de points de vue, parmi ses rangs, tout comme il existe une pluralité de relations dans le monde extérieur. Ce débat fait du bien parce qu’il vous ouvre. Bien sûr, il ne s’agit pas de tolérer tout et n’importe quoi : un fondamentalisme qui condamne les autres n’est pas acceptable ». Difficile de croire, en entendant ces paroles libérales, que Samuel Lutz ait été élevé dans un milieu piétiste et que son père ait présidé l’Alliance évangélique suisse.
Les thèmes de débat dans l’Eglise, « nous les trouvons simplement en étant attentifs à ce qui nous entoure. Nous apparaissons toujours comme une Eglise excentrée, mais il existe aussi des situations de pauvreté en ville de Berne, par exemple à Berne-ouest qui compte beaucoup de résidents étrangers et d’enfants. Or, en périphérie, la poste ferme, bientôt l’école et le pasteur doit réduire son temps de travail. Ce n’est pas le rôle de l’Eglise de proposer un programme, mais il faut aussi savoir aller trouver le gouvernement cantonal quand les choses ne vont plus ».
Le personnage a plusieurs facettes. Sa mère était d’origine huguenote, d’où peut-être son intérêt de chercheur pour l’histoire de la Réforme, qu’il a dû abandonner durant ses années de Conseil synodal (de 1988 à 1993, puis dès 1996 comme président à plein temps). « Je vais apprendre une nouvelle manière de vivre, retravailler mon piano, rencontrer d’autres gens », se réjouit celui qui avoue n’avoir jusqu’alors« rien fait d’autre que travailler ».











