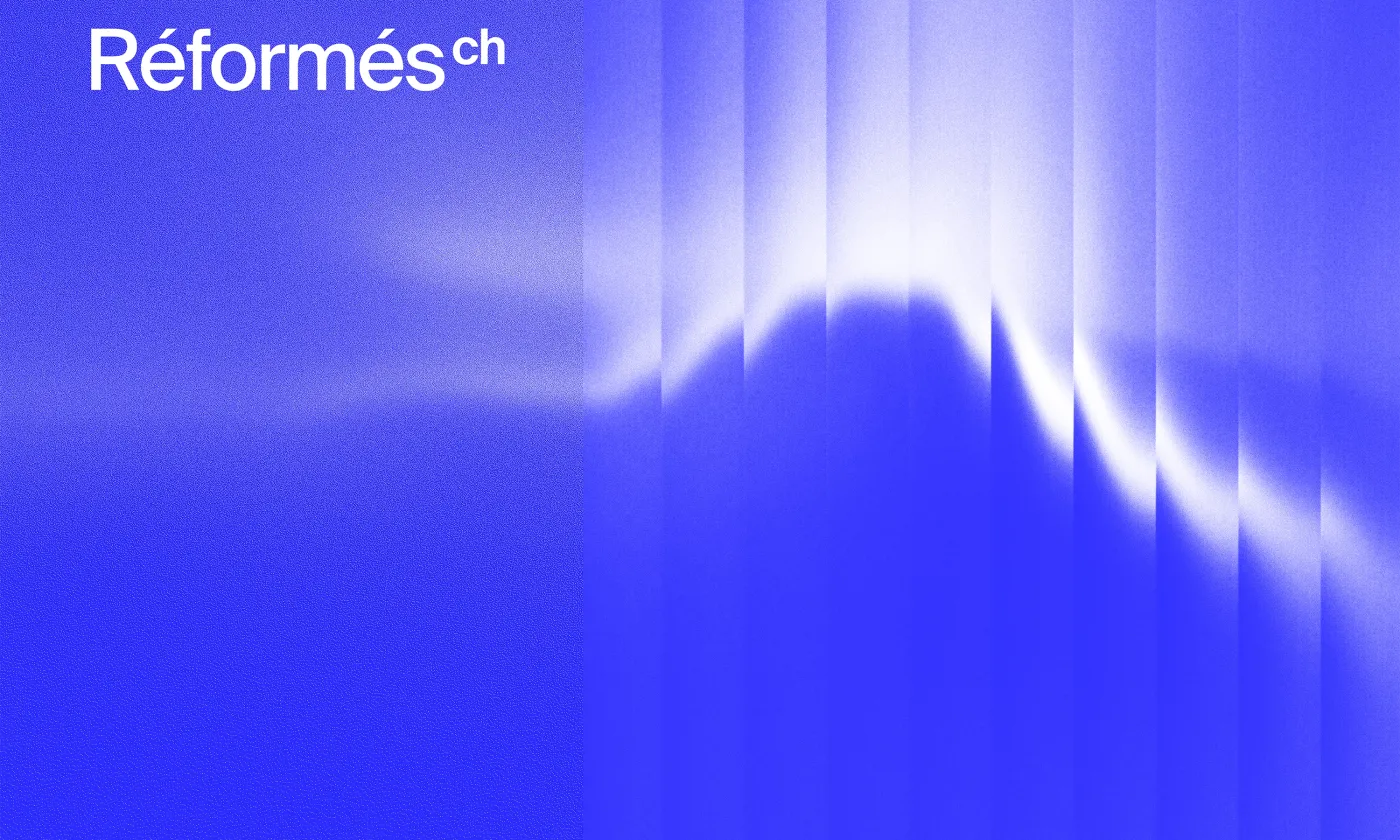
Isabelle Graesslé, directrice du Musée international de la Réforme à Genève, brosse le portrait de "son" Calvin
Dans son minuscule bureau de la Maison Mallet qui abrite le Musée internationale dse la Réforme, Isabelle Graesslé rappelle qu’il faut absolument replacer Calvin dans son époque, - le début du XVIe siècle -, fondamentalement différente de la nôtre, afin de dépasser la distance culturelle qui nous sépare aujourd’hui du réformateur français de Genève.
« Il faut lorgner dans les interstices de l’histoire et les replis du temps, et bien s’imaginer une époque rude et austère, une ville de Genève où il fait perpétuellement froid dans les maisons, car les fenêtres sont pourvues de vitres de papier, où l’eau du lac est souvent insalubre, où les fontaines sont rares et les épidémies fréquentes, où la mortalité enfantine était est très élevée», explique Isabelle Graesslé, qui fut la première modératrice de la Compagnie des pasteurs de Genève.
Le tableau est brossé : les temps étaient austères et l’esprit n’était pas à la tolérance. Calvin lui-même, dans certains de ses sermons, considérait son époque comme « particulièrement malheureuse ». A plusieurs reprises, comme nous rappelle le théologien américain Christopher Elwood dans son livre, « Calvin sans trop se fatiguer »*, le réformateur évoque l’état du monde de manière sombre : «Que voyons-nous dans ce monde aujourd’hui si ce n’est des troubles partout ?... Où trouver un petit coin sur terre qui est resté paisible pour un temps raisonnable ? ».
Mais Calvin n’était pas seulement marqué par l’austérité de son époque. En se plongeant dans la correspondance de Jean Calvin, Isabelle Graesslé a découvert un personnage qui aime faire des excursions à cheval du côté de Satigny, à la recherche de bonnes auberges, avec ses amis Guillaume Farel, le prédicateur qui l’a fait venir à Genève, et Pierre Viret, le réformateur vaudois. Si Jean Calvin n’était manifestement pas un jouisseur personnage comique, il avait toutefois un sens très vif de l’humour. « La gaudriole lui apparaissait comme une offense à la vocation humaine qui était, pour lui, d’être de devenir la meilleure personne possible, et d’être confiante et fidèle », reconnaît la directrice du Musée. Mais voilà. Comme n’importe qui, Calvin avait peur : peur de mourir d’une des épidémies de peste qui sévissaient en Europe, peur qu’on lui veuille du mal. Car les calomnies et les critiques de ses détracteurs et de ses adversaires étaient fréquentes, notamment après la dispute de Lausanne ou après le procès de Michel Servet, brûlé vif pour ses convictions jugées hérétiques, dont Calvin a été le principal accusateur. Calvin était effrayé par son époque chaotique, qu’il chercha à organiser parfois de façon disciplinaire dictatoriale.
« Il est difficile, à 500 ans de distance, de faire une approche psychologique crédible du caractère de Calvin sur la seule base de ses propres citations, reconnaît la gardienne de la mémoire réformée à Genève. Tout laisse à penser cependant que c’était un homme au caractère véhément, qui piquait de temps en temps des colères mémorables, qui pouvaient tourner en véritables crises : il se roulait parfois par terre dans sa chambre en hurlant. Il ne supportait pas de se sentir lâché par les autres, ni contesté. Ceux-ci n’existaient plus pour lui. Quand l’un de ses amis, Louis du Tillet, qui avait adopté les idées de la Réforme et l’avait accompagné à Genève en 1536, décida de retourner à l’Église mère, (le catholicisme), Calvin lui écrivit une dernière lettre véhémente pour sceller leur rupture. « C’était un homme à la sensibilité à fleur de peau », dit-elle pudiquement.
Mais ce qu’Isabelle Graesslé retient de Calvin, le père de la doctrine de la prédestination, c’est avant tout le fait qu’il a « vidé le ciel de toute médiation » : il n’est plus nécessaire de passer par qui que ce soit pour entrer en relation avec Dieu, ce qui donne une immense liberté à l’homme et prépare la modernité. Calvin affirme que Dieu est en soi connaissable par tout homme humain, que le sentiment qu’il y a un Dieu est imprimé dans les cœurs ». Avec Luther, Calvin met la Bible au centre de la réflexion théologique, parce que c’est, à ses yeux, la manière dont chacun peut entendre la Parole de Dieu. Isabelle Graesslé souligne ses intuitions géniales, la finesse et la beauté de sa langue, son apport à la langue française qu’avec Rabelais il a façonnée, la force de son style et de sa rhétorique.
Il crée l’Académie de Genève en 1559 pour offrir une instruction de haut niveau aux futurs pasteurs et développer l’enseignement du grec et de l’hébreu afin de permettre aux étudiants d’avoir directement accès aux textes bibliques.











