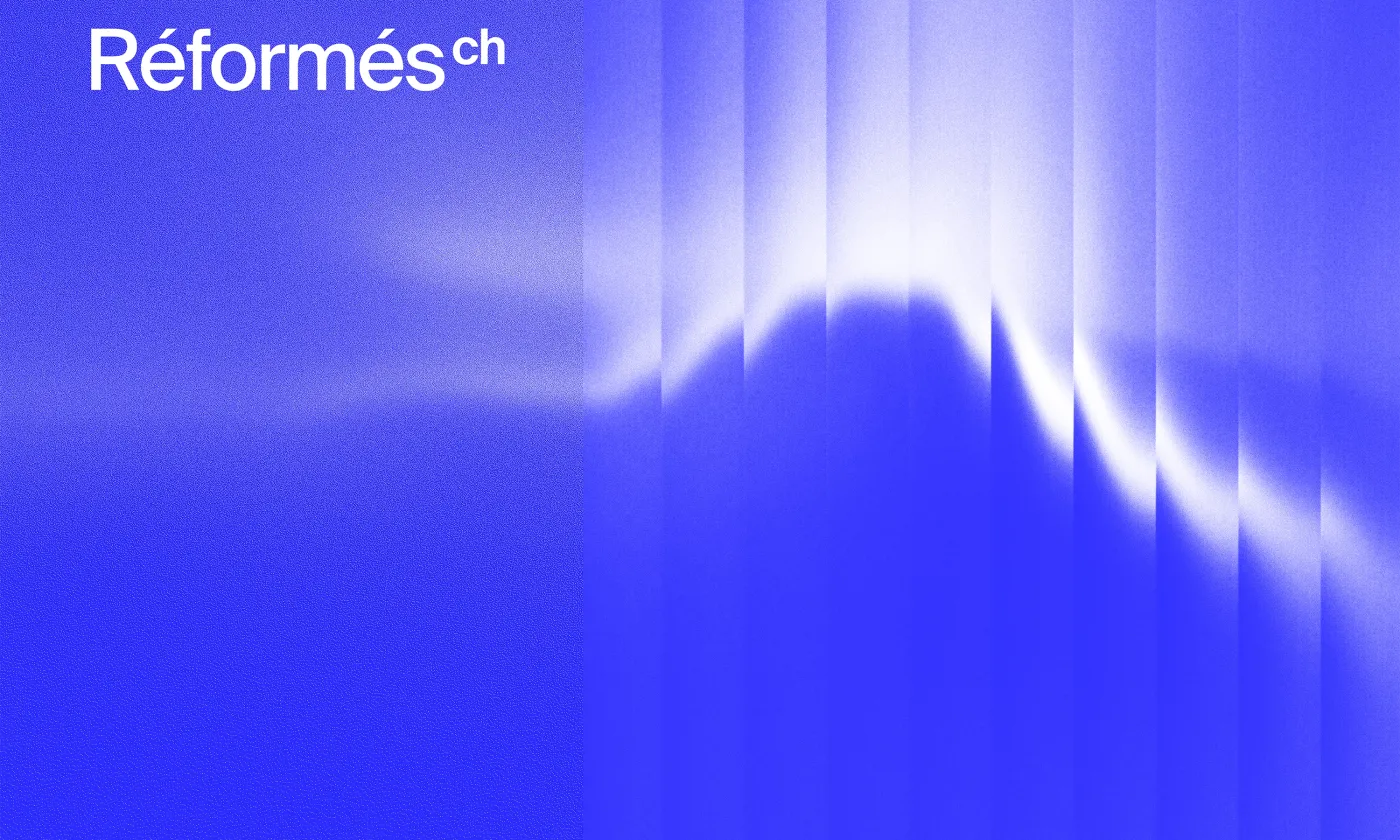
La réédition du livre de Stefan Zweig, « Conscience contre violence », après 50 ans de silence, rappelle la face d’ombre de Calvin
Stefan Zweig a rédigé son texte prémonitoire en 1936, en pleine montée du fascisme. Ce document polémique garde encore aujourd’hui toute sa force et sa pertinence pour notre temps.
L’écrivain fait revivre le conflit qui opposa Calvin à Sébastien Castellion, un humaniste d’origine savoyarde rallié à la Réforme, et émigré à Genève où il est traducteur et enseignant. Ami de Calvin, il reprocha à se dernier d’avoir livré l’humaniste Michel Servet au bûcher parce que ce dernier avait osé s’élever contre lui à propos de la Trinité, et avait toujours refusé de se rétracter.
Il a fallu beaucoup de courage à Sébastien Castellion pour publier sa protestation passionnée contre la dictature théocratique de Calvin. Il savait très bien à quel adversaire formidable il s’affrontait en accusant publiquement Calvin d’avoir tué un homme, et par là même, la liberté de conscience au sein de la Réforme. Castellion rappelle en 1554 dans son traité « De l'impunité des hérétiques" que les idées ne s’imposent pas par la subordination forcée. Il dénonce l’intransigeance de Calvin, qui n’admettait aucune liberté, pas plus dans les choses de la religion que dans celles de la vie ordinaire. Pour le Réformateur de Genève, l’Eglise avait non seulement le droit, mais aussi le devoir d’imposer une obéissance totale à tous les hommes, et même à « punir sans ménagement la simple tiédeur ». Sébastien Castellion a un courage inouï à une époque où la chasse aux hérétiques se pratique couramment, où l’on traque, on pend, on brûle, on noie des gens qui n’ont commis aucun crime contre Dieu et l’Etat. Leur liberté de conscience est devenue un délit de droit commun.
« C’est le combat du moucheron contre l’éléphant », résume Stefan Zweig qui détaille toutes les persécutions dont Castellion est victime. Excommunié, privé de son gagne-pain, interdit d’écriture, calomnié, poursuivi par les zélés de la peur et les mouchards, il ne faiblit jamais. De Bâle où il s’est réfugié et vivote difficilement, il rédige un appel émouvant à la paix et défend avec une élégance rare, dans une lettre à Calvin un pacifisme humanitaire. Les mots de Castellion n’ébranlent pas Calvin qui n’admet qu’une une seule vérité, la sienne. « Ce que j’enseigne, je le tiens de Dieu, ma conscience me le confirme », écrit-il. Le contredire, c’est donc offenser l’honneur de Dieu.
Castellion reste fidèle à lui-même. Il est prêt, pour défendre la liberté de conscience et son idée d’une Réforme libérale, à payer n’importe quel prix. Pour lui, l’Evangile n’est pas un code sévère mais un modèle d’éthique. Dans son « Traité des hérétiques », il écrit à Calvin : « Combien il m’eût été plus doux de discuter avec toi en toute fraternité et dans l’esprit du Christ, et non à la façon des païens, avec des injures qui ne peuvent que porter un grand préjudice à l’Eglise ». Il écrit aussi à ceux que Calvin exhorte à exterminer impitoyablement tous ceux qui sont jugés hérétiques : « Penchez plutôt du côté de la douceur et n’écoutez pas ceux qui vous exhortent au meurtre… ».
Calvin n’est pas le moins impressionné par les mots de Castellion. Il enrage et s’acharne à discréditer son ancien ami, à le comparer à Satan. « Que Dieu t’écrase, Satan », lance-t-il à l’adresse de son contradicteur. il n’aura de cesse de faire censurer ses écrits, de le faire espionner, de détruire systématiquement sa vie. Continuellement persécuté, Castellion meurt le 29 décembre 1563, à l’âge de 48 ans, « arraché par la bonté de Dieu aux griffes de ses adversaires », selon l’expression d’un de ses amis .
« L’histoire n’est qu’un perpétuel recommencement, un droit n’est jamais conquis définitivement ni aucune liberté à l’abri de la violence » avertit, en conclusion, Stefan Zweig, qui sait trop bien de quoi il parle. Ecrivain juif autrichien, il a vu ses écrits brûlés sur la place publique dans toutes les grandes villes allemandes. Pour échapper aux persécutions nazies, il se réfugie au Brésil où il se donne la mort en 1942.











