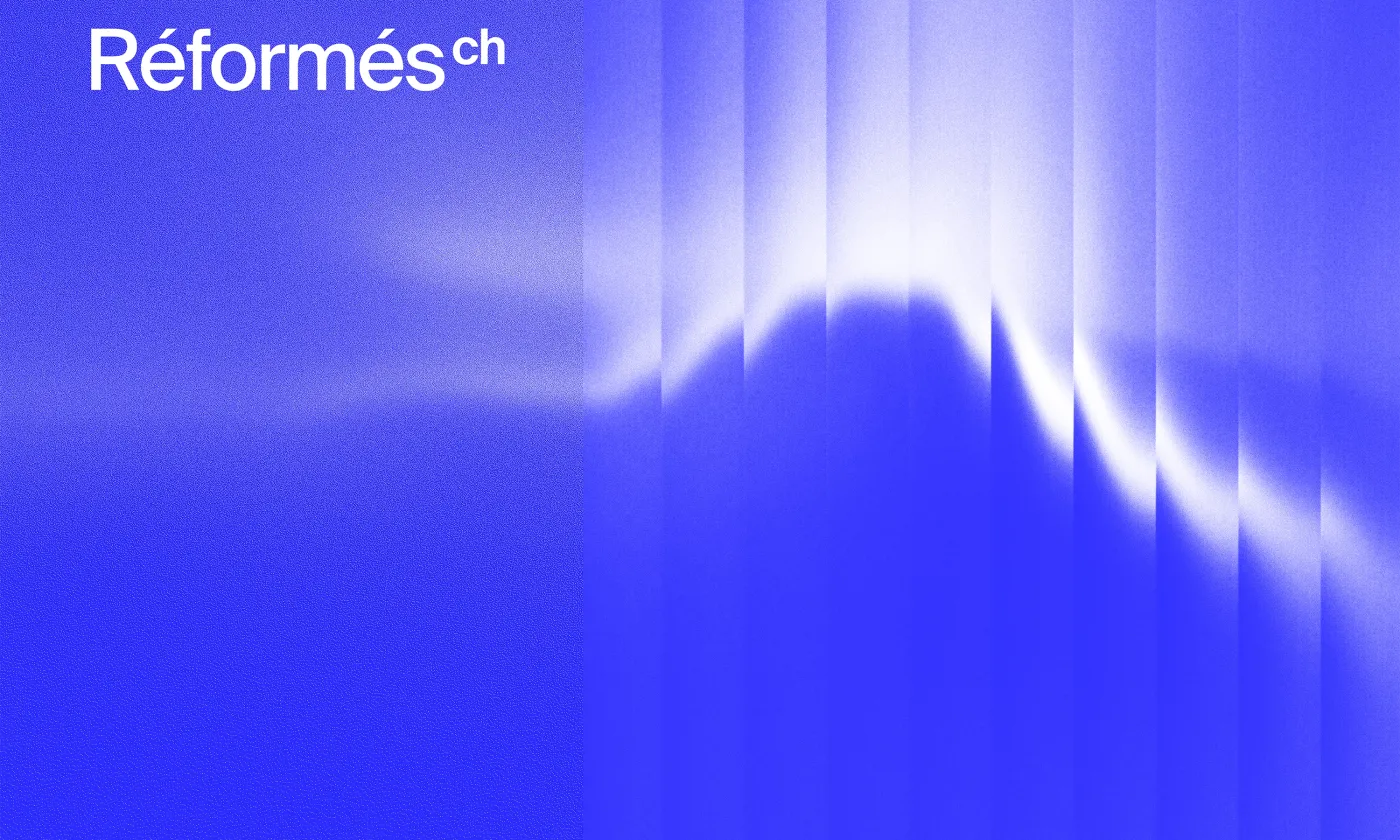
i
[pas de légende]
Nouveau partenariat académique romand pour la théologie et les sciences des religions
Les facultés romandes de théologie protestantes entrent dans une nouvelle collaboration
Les recteurs des trois Universités romandes (VD, GE, NE) ont opté pour un partenariat en théologie protestante et sciences des religions (TPSR). Après des années de réflexion et des relations parfois tendues, les nouvelles options semblent convenir aux facultés.
Il s'agit d'une coopération inédite entre Universités en Suisse. Les Recteurs du Triangle Azur ont signé vendredi une nouvelle convention qui instaure une nouvelle coopération entre les trois facultés de théologie protestante et l'étend aux sciences des religions.
Même si le partenariat présenté vendredi paraît complexe et soulève des questions quant à l'organisation concrète de ses structures, les recteurs l'affirment : il s'agit de simplifier les structures, mieux organiser les enseignements, renforcer les pôles de compétence et favoriser les synergies entres les trois facultés. « Avec cette nouvelle convention, on fait vraiment les choses ensemble », explique Jean-Dominique Vassalli, recteur de l'Université de Genève.
À défaut de rationalisation, on préfère parler d'optimisation. « Le nombre d'étudiants en théologie est relativement faible, et ceux-ci profiteront d'une offre de cours plus étoffée », souligne Martine Rahier, rectrice de l'Université de Neuchâtel. « De plus, nous pourrons supprimer les doublons de cours », ajoute-t-elle. La suite d'une collaboration établie Cette nouvelle convention prend le relais de la fédération des facultés de théologie de Lausanne, Genève et Neuchâtel, signée en 2004 dans le mouvement d'adaptation au processus de Bologne. Elle institue trois collèges ancrés chacun sur l'un des trois sites et responsables des enjeux de l'enseignement : le collège de théologie protestante à Genève, la formation continue en théologie à Neuchâtel, et les sciences des religions à Lausanne. Des professeurs des trois facultés sont présents dans chacun de ces collèges.
Avec cette nouvelle convention, on ne réfléchit donc plus vraiment les études par faculté, mais plutôt par collège. Chaque étudiant peut s'immatriculer dans la faculté de son choix et pourra étudier sur les trois sites. Chaque collège coordonne les questions liées à l'enseignement de sa discipline.
En ce qui concerne la recherche, la convention redéfinit également les pôles de compétences des trois facultés. Genève héberge la théologie systématique et éthique ainsi que l'histoire du christianisme, en lien avec l'histoire de la Réformation. À Lausanne, on trouve les sciences bibliques, l'anthropologie et l'histoire des religions ainsi que la sociologie et psychologie des religions. Neuchâtel enfin se voit spécialisée en théologie pratique et en culture chrétienne.
Concrètement, ce partenariat élargit le périmètre de la fédération en harmonisant l'enseignement au niveau du bachelor (seul le master était commun jusqu'ici), des programmes doctoraux et de la formation continue. Il intègre également plus clairement les sciences des religions. Sciences des religions et théologie : je t'aime, moi non plus Un conflit avait d'ailleurs opposé les points de vue portés sur ces deux disciplines à Lausanne, hébergées toutes deux au sein de la même faculté. Exprimé dans les médias par des prises de position et lettres ouvertes de professeurs concernés, il avait donné une image peu encourageante des projets de changement.
C'est visiblement de l'histoire ancienne. « Nous avons discuté avec tous les acteurs des disciplines concernées par cette convention », indique Dominique Arlettaz, recteur de l'Université de Lausanne. « Les craintes ressenties par les professeurs de sciences des religions d'être minorisés au sein d'une grande structure n'ont plus lieu d'être », relève-t-il. Au contraire, avec ce partenariat et le collège de sciences des religions, ces branches jouissent d'une meilleure position et d'une plus grande visibilité, selon les recteurs.
Quant aux sciences des religions de l'Université de Genève, rattachées à la faculté des Lettres, la question de leur collaboration reste ouverte. « Elles peuvent collaborer », répond prudemment Jean-Dominique Vassalli. « Mais nous n'allons pas les contraindre. Nous verrons comment cela peut s'intégrer dans la collaboration », précise le recteur de l'uni de Genève. La théologie reste ancrée dans les cantons Des craintes de fermeture de faculté avaient agité le monde académique et théologique romand ces deux dernières années. « Nous avons réfléchi à l'option d'une seule faculté sur un ou plusieurs sites, indique Dominique Arlettaz. Mais nous avons dû respecter le cadre légal qui ancre les facultés de théologie dans leurs terreaux respectifs. Plutôt que d'engager un énorme processus visant à modifier des lois, nous avons opté pour ce partenariat qui vise l'efficacité. »
Car la théologie a tout de même une spécificité dans son insertion cantonale. « Cette discipline est inscrite dans l'histoire des institutions et dans l'environnement social », souligne Jean-Dominique Vassalli. « A Neuchâtel et Genève, des conventions et concordats lient les facultés aux Églises locales », relève pour sa part Lytta Basset. « Cet enracinement historique et culturel a pu compliquer les choses », ajoute-t-elle.
La Faculté de théologie de Genève jouit par exemple d'un statut particulier. Définie comme « autonome », elle est régie par une fondation dans laquelle l'Église protestante est présente. « La fondation a toujours été prête à la collaboration au niveau romand, indique Jean-Dominique Vassalli, mais c'est vrai que la vision genevoise considère que Calvin c'est Genève, et que Genève doit donc être le centre de la collaboration ». Un partenariat où les partenaires vont trouver leurs places Au final, les facultés peuvent s'estimer satisfaites du contenu de cette nouvelle convention. « Dans ce processus qui a été très délicat, je suis admirative du travail accompli par les recteurs », souligne ainsi Lytta Basset. Avec cette nouvelle convention, la faculté de Neuchâtel sort d'ailleurs renforcée, puisqu'elle gagne un pôle de compétence en plus. « Neuchâtel avait dû faire beaucoup de sacrifice avec la précédente convention, notamment en abandonnant son institut d'herméneutique religieuse et la filière associée », rappelle Lytta Basset.
« Tout cela devra encore être mis en oeuvre, l'année qui vient est une année de transition », relève Lytta Basset. Les éventuelles réticences persistantes devront être dépassées. « Il faudra travailler sur la base d'une volonté commune pour le bien de tous», indique pour sa part Jean-Dominique Vassalli. « C'est un peu comme dans un couple. Quand on se met en partenariat, on perd une partie de ses prérogatives ».
Dans ce ménage à trois que définissent ainsi les trois universités, il faudra voir comment la collaboration évoluera. La Conférence universitaire suisse a pour sa part apporté sa bénédiction à ce projet en accordant un soutien financier de 4 millions de francs, une somme non négligeable pour les budgets des trois facultés, et qui doit permettre de nouvelles nominations en « tuilage » pour répondre aux prochains départs à la retraite de professeurs. Conclu jusqu'à fin juillet 2012, le partenariat sera alors à nouveau évalué.
Même si le partenariat présenté vendredi paraît complexe et soulève des questions quant à l'organisation concrète de ses structures, les recteurs l'affirment : il s'agit de simplifier les structures, mieux organiser les enseignements, renforcer les pôles de compétence et favoriser les synergies entres les trois facultés. « Avec cette nouvelle convention, on fait vraiment les choses ensemble », explique Jean-Dominique Vassalli, recteur de l'Université de Genève.
À défaut de rationalisation, on préfère parler d'optimisation. « Le nombre d'étudiants en théologie est relativement faible, et ceux-ci profiteront d'une offre de cours plus étoffée », souligne Martine Rahier, rectrice de l'Université de Neuchâtel. « De plus, nous pourrons supprimer les doublons de cours », ajoute-t-elle. La suite d'une collaboration établie Cette nouvelle convention prend le relais de la fédération des facultés de théologie de Lausanne, Genève et Neuchâtel, signée en 2004 dans le mouvement d'adaptation au processus de Bologne. Elle institue trois collèges ancrés chacun sur l'un des trois sites et responsables des enjeux de l'enseignement : le collège de théologie protestante à Genève, la formation continue en théologie à Neuchâtel, et les sciences des religions à Lausanne. Des professeurs des trois facultés sont présents dans chacun de ces collèges.
Avec cette nouvelle convention, on ne réfléchit donc plus vraiment les études par faculté, mais plutôt par collège. Chaque étudiant peut s'immatriculer dans la faculté de son choix et pourra étudier sur les trois sites. Chaque collège coordonne les questions liées à l'enseignement de sa discipline.
En ce qui concerne la recherche, la convention redéfinit également les pôles de compétences des trois facultés. Genève héberge la théologie systématique et éthique ainsi que l'histoire du christianisme, en lien avec l'histoire de la Réformation. À Lausanne, on trouve les sciences bibliques, l'anthropologie et l'histoire des religions ainsi que la sociologie et psychologie des religions. Neuchâtel enfin se voit spécialisée en théologie pratique et en culture chrétienne.
Concrètement, ce partenariat élargit le périmètre de la fédération en harmonisant l'enseignement au niveau du bachelor (seul le master était commun jusqu'ici), des programmes doctoraux et de la formation continue. Il intègre également plus clairement les sciences des religions. Sciences des religions et théologie : je t'aime, moi non plus Un conflit avait d'ailleurs opposé les points de vue portés sur ces deux disciplines à Lausanne, hébergées toutes deux au sein de la même faculté. Exprimé dans les médias par des prises de position et lettres ouvertes de professeurs concernés, il avait donné une image peu encourageante des projets de changement.
C'est visiblement de l'histoire ancienne. « Nous avons discuté avec tous les acteurs des disciplines concernées par cette convention », indique Dominique Arlettaz, recteur de l'Université de Lausanne. « Les craintes ressenties par les professeurs de sciences des religions d'être minorisés au sein d'une grande structure n'ont plus lieu d'être », relève-t-il. Au contraire, avec ce partenariat et le collège de sciences des religions, ces branches jouissent d'une meilleure position et d'une plus grande visibilité, selon les recteurs.
Quant aux sciences des religions de l'Université de Genève, rattachées à la faculté des Lettres, la question de leur collaboration reste ouverte. « Elles peuvent collaborer », répond prudemment Jean-Dominique Vassalli. « Mais nous n'allons pas les contraindre. Nous verrons comment cela peut s'intégrer dans la collaboration », précise le recteur de l'uni de Genève. La théologie reste ancrée dans les cantons Des craintes de fermeture de faculté avaient agité le monde académique et théologique romand ces deux dernières années. « Nous avons réfléchi à l'option d'une seule faculté sur un ou plusieurs sites, indique Dominique Arlettaz. Mais nous avons dû respecter le cadre légal qui ancre les facultés de théologie dans leurs terreaux respectifs. Plutôt que d'engager un énorme processus visant à modifier des lois, nous avons opté pour ce partenariat qui vise l'efficacité. »
Car la théologie a tout de même une spécificité dans son insertion cantonale. « Cette discipline est inscrite dans l'histoire des institutions et dans l'environnement social », souligne Jean-Dominique Vassalli. « A Neuchâtel et Genève, des conventions et concordats lient les facultés aux Églises locales », relève pour sa part Lytta Basset. « Cet enracinement historique et culturel a pu compliquer les choses », ajoute-t-elle.
La Faculté de théologie de Genève jouit par exemple d'un statut particulier. Définie comme « autonome », elle est régie par une fondation dans laquelle l'Église protestante est présente. « La fondation a toujours été prête à la collaboration au niveau romand, indique Jean-Dominique Vassalli, mais c'est vrai que la vision genevoise considère que Calvin c'est Genève, et que Genève doit donc être le centre de la collaboration ». Un partenariat où les partenaires vont trouver leurs places Au final, les facultés peuvent s'estimer satisfaites du contenu de cette nouvelle convention. « Dans ce processus qui a été très délicat, je suis admirative du travail accompli par les recteurs », souligne ainsi Lytta Basset. Avec cette nouvelle convention, la faculté de Neuchâtel sort d'ailleurs renforcée, puisqu'elle gagne un pôle de compétence en plus. « Neuchâtel avait dû faire beaucoup de sacrifice avec la précédente convention, notamment en abandonnant son institut d'herméneutique religieuse et la filière associée », rappelle Lytta Basset.
« Tout cela devra encore être mis en oeuvre, l'année qui vient est une année de transition », relève Lytta Basset. Les éventuelles réticences persistantes devront être dépassées. « Il faudra travailler sur la base d'une volonté commune pour le bien de tous», indique pour sa part Jean-Dominique Vassalli. « C'est un peu comme dans un couple. Quand on se met en partenariat, on perd une partie de ses prérogatives ».
Dans ce ménage à trois que définissent ainsi les trois universités, il faudra voir comment la collaboration évoluera. La Conférence universitaire suisse a pour sa part apporté sa bénédiction à ce projet en accordant un soutien financier de 4 millions de francs, une somme non négligeable pour les budgets des trois facultés, et qui doit permettre de nouvelles nominations en « tuilage » pour répondre aux prochains départs à la retraite de professeurs. Conclu jusqu'à fin juillet 2012, le partenariat sera alors à nouveau évalué.











