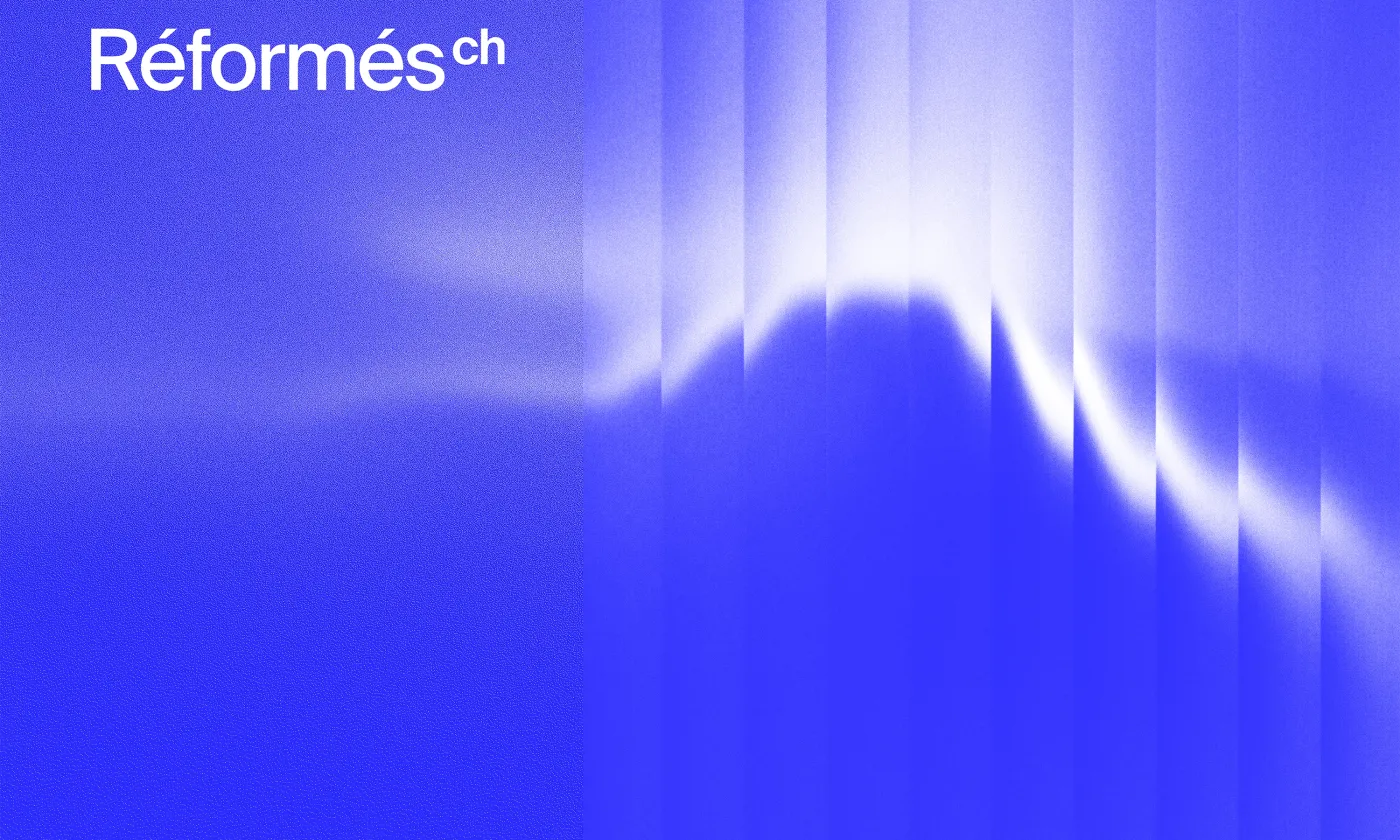
i
[pas de légende]
La nouvelle Suisse religieuse: entre sécularisation et nouvelles communautés
La Suisse change. Avec l'arrivée des derniers immigrants, de nouvelles religions sont apparues en terres helvétiques
Parallèlement, le Suisse s'est éloigné des religions historiques. Face à ces mutations, la démocratie suisse est placée devant un défi. Pratiquement toutes les religions sont représentées en Suisse: 491 groupes religieux ont été dénombrés, révèle un ouvrage à paraître*, publié sous la responsabilité de Martin Baumann et de Jörg Stolz, sociologues des religions. Pour la vingtaine de chercheurs qui ont travaillé sous leur direction, cette nouvelle diversité comporte des risques pour la société suisse, mais aussi des chances. Sortir du fantasmeEn quelques décennies, la visage de la Suisse s'est transformé. Si les chrétiens restent majoritaires avec près de 80% de la population, ils étaient toutefois 98% en 1970. Depuis, les personnes sans appartenance religieuse (11,1%) et les musulmans (4, 26%) ont fait une forte percée. Les chiffres sont connus depuis le dernier recensement fédéral de 2000, mais cet ouvrage, en donnant des informations factuelles sur les différentes communautés, permet de sortir du fantasme.
C'est particulièrement le cas concernant les musulmans. Ces derniers sont souvent perçus comme appartenant à un seul groupe, ce qui est loin d'être le cas. Concrètement, 58% d'entre eux sont originaires d'ex-Yougoslavie, 21% de Turquie, 4% d'Afrique noire, d'Asie et du Maghreb et 2% du Proche-Orient. Enfin, 11% des musulmans sont de nationalité suisse.
Pour comprendre les problèmes d'intégration, une analyse en terme de classes sociales ne doit pas être écartée face au tout religieux. Les musulmans, qui appartiennent le plus souvent aux classes sociales inférieures, sont de ce fait particulièrement exposés au chômage ou à la pauvreté, peut-on lire dans l'étude.
Or si on analyse ces chiffres sans prendre ce fait en compte, on pourrait aboutir à la conclusion erronée que les musulmans s'intègrent moins facilement uniquement en raison de leurs spécificités religieuses et culturelles.Société en transformationSi la mutation du paysage religieux en Suisse est relativement récente, Jörg Stolz, directeur de l'Observatoire des religions à l'Université de Lausanne, est frappé par « les effets profonds de cette nouvelle pluralité sur l'ensemble de la société », a-t-il expliqué à Protestinfo. L'école, la justice, la médecine, les Eglises historiques, pour ne citer que ces secteurs, ont déjà dû modifier leurs pratiques.
Tandis qu'une partie de la population devient de plus en plus religieuse, une autre se sécularise toujours davantage. Pour ne pas perdre du terrain, des partis politiques comme le parti démocrate- chrétien (PDC) ou des organisations non gouvernementales comme l'Entraide protestante (EPER) ont d'ailleurs tenté de gommer leur origine chrétienne.
Le détachement des Suisses des religions historiques fait peur aux Eglises, qui craignent de devenir minoritaires à l'avenir. Les Suisses se révèlent friands d'une spiritualité à la carte, sans dieu. Confrontée à une indifférence teintée d'ésotérisme d'une part et à l'arrivée de nouvelles religions d'autre part, les Eglises doivent encore faire face en leur sein aux différentes manières de vivre la foi chrétienne des nouveaux migrants.Risque: le déniFace à la nouvelle pluralité religieuse, l'un des plus grands risques est le déni, selon le chercheur. « C'est croire par exemple que si l'on ne voit pas de minarets, les musulmans ne sont pas là. » Or la visibilité facilite l'intégration, estime le sociologue. De cette manière, les communautés peuvent entrer en contact les unes avec les autres. Elles peuvent ainsi obtenir des droits, mais « on peut également leur rappeler leurs responsabilités », relève-t-il.
Un deuxième risque est l'idéologisation du fait religieux. Une idéologisation entraîne stigmatisation et fantasmes pour aboutir à la phobie. Un troisième risque est un multiculturalisme à outrance sur fond de tolérance molle, estime le chercheur lausannois.
La Suisse fait face aux mêmes mutations que les autres pays industrialisés, mais elle est mieux armée pour gérer cette pluralité, défend M. Stolz. La Suisse moderne a été bâtie sur le conflit entre catholiques et réformés, rappelle-t-il. Elle a dès lors développé une quasi science de la coexistence confessionnelle.
La Suisse sait négocier et faire négocier des groupes entre eux. « Elle a un savoir-faire en la matière qu'elle a tendance à oublier ». Dans ce contexte, les politiques trouvent une nouvelle utilité aux Eglises historiques, chargées d'organiser le champ religieux en incitant les nouvelles communautés à se fédérer pour exister sur le plan légal.
NOTE: « La nouvelle Suisse religieuse. Risques et chances de sa diversité », sous la direction de Martin Baumann et Jörg Stolz, Editions Labor et Fides, 424 pages. Sortie prévue en librairie le 21 avril.
C'est particulièrement le cas concernant les musulmans. Ces derniers sont souvent perçus comme appartenant à un seul groupe, ce qui est loin d'être le cas. Concrètement, 58% d'entre eux sont originaires d'ex-Yougoslavie, 21% de Turquie, 4% d'Afrique noire, d'Asie et du Maghreb et 2% du Proche-Orient. Enfin, 11% des musulmans sont de nationalité suisse.
Pour comprendre les problèmes d'intégration, une analyse en terme de classes sociales ne doit pas être écartée face au tout religieux. Les musulmans, qui appartiennent le plus souvent aux classes sociales inférieures, sont de ce fait particulièrement exposés au chômage ou à la pauvreté, peut-on lire dans l'étude.
Or si on analyse ces chiffres sans prendre ce fait en compte, on pourrait aboutir à la conclusion erronée que les musulmans s'intègrent moins facilement uniquement en raison de leurs spécificités religieuses et culturelles.Société en transformationSi la mutation du paysage religieux en Suisse est relativement récente, Jörg Stolz, directeur de l'Observatoire des religions à l'Université de Lausanne, est frappé par « les effets profonds de cette nouvelle pluralité sur l'ensemble de la société », a-t-il expliqué à Protestinfo. L'école, la justice, la médecine, les Eglises historiques, pour ne citer que ces secteurs, ont déjà dû modifier leurs pratiques.
Tandis qu'une partie de la population devient de plus en plus religieuse, une autre se sécularise toujours davantage. Pour ne pas perdre du terrain, des partis politiques comme le parti démocrate- chrétien (PDC) ou des organisations non gouvernementales comme l'Entraide protestante (EPER) ont d'ailleurs tenté de gommer leur origine chrétienne.
Le détachement des Suisses des religions historiques fait peur aux Eglises, qui craignent de devenir minoritaires à l'avenir. Les Suisses se révèlent friands d'une spiritualité à la carte, sans dieu. Confrontée à une indifférence teintée d'ésotérisme d'une part et à l'arrivée de nouvelles religions d'autre part, les Eglises doivent encore faire face en leur sein aux différentes manières de vivre la foi chrétienne des nouveaux migrants.Risque: le déniFace à la nouvelle pluralité religieuse, l'un des plus grands risques est le déni, selon le chercheur. « C'est croire par exemple que si l'on ne voit pas de minarets, les musulmans ne sont pas là. » Or la visibilité facilite l'intégration, estime le sociologue. De cette manière, les communautés peuvent entrer en contact les unes avec les autres. Elles peuvent ainsi obtenir des droits, mais « on peut également leur rappeler leurs responsabilités », relève-t-il.
Un deuxième risque est l'idéologisation du fait religieux. Une idéologisation entraîne stigmatisation et fantasmes pour aboutir à la phobie. Un troisième risque est un multiculturalisme à outrance sur fond de tolérance molle, estime le chercheur lausannois.
La Suisse fait face aux mêmes mutations que les autres pays industrialisés, mais elle est mieux armée pour gérer cette pluralité, défend M. Stolz. La Suisse moderne a été bâtie sur le conflit entre catholiques et réformés, rappelle-t-il. Elle a dès lors développé une quasi science de la coexistence confessionnelle.
La Suisse sait négocier et faire négocier des groupes entre eux. « Elle a un savoir-faire en la matière qu'elle a tendance à oublier ». Dans ce contexte, les politiques trouvent une nouvelle utilité aux Eglises historiques, chargées d'organiser le champ religieux en incitant les nouvelles communautés à se fédérer pour exister sur le plan légal.
NOTE: « La nouvelle Suisse religieuse. Risques et chances de sa diversité », sous la direction de Martin Baumann et Jörg Stolz, Editions Labor et Fides, 424 pages. Sortie prévue en librairie le 21 avril.











