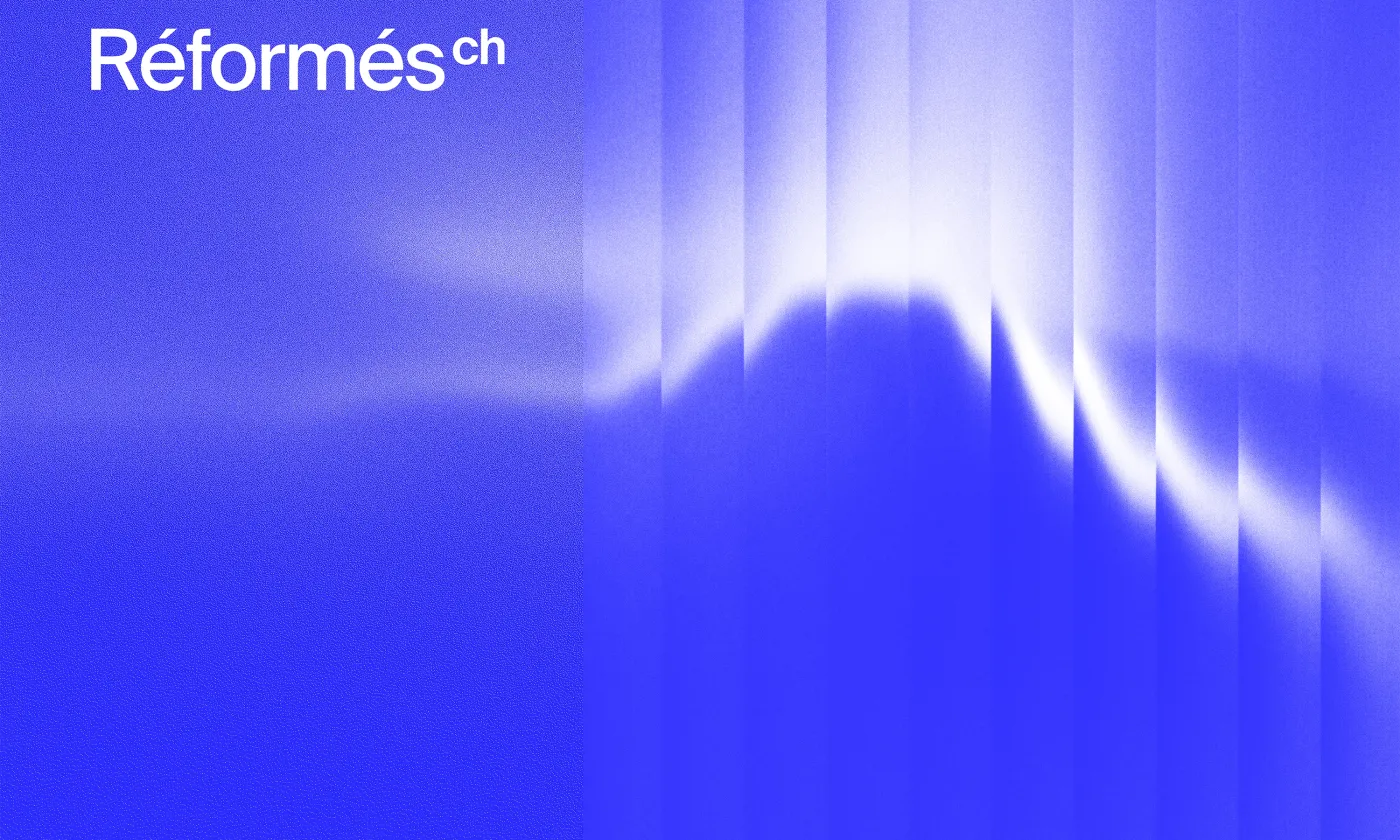
« Du pain, pas des pierres ! » : Naissance de la théologie féministe de la libération
Une tension existe dès le début au cœur des communautés chrétiennes. Les études que Mme Schüssler Fiorenza conduit en herméneutique, examinent l’histoire du commencement du christianisme.
On y lit, non pas le paysage unifié, idéalisé, que l’enseignement a longtemps présenté, mais une constellation de très petites communautés, dont une partie pratiquent l’égalité entre disciples. Elle a rendu compte minutieusement de sa recherche en publiant, en 1986, son livre le plus célèbre intitulé « En mémoire d’elle ». Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe.
Cette mémoire retrouvée modifie la vision ecclésiale du présent. Les conflits actuels, intra - ecclésiaux ou encore entre l’Eglise et les cultures, prennent une toute autre allure sous cet éclairage des débuts du christianisme. Le conflit de valeurs entre fidélité au message et adaptation sociale, entre les veines patriarcale et prophétique des communautés, fait partie de la situation.
Une époque n’est pas meilleure que l’autre. E. Schüssler Fiorenza se situera, dès lors, au cœur des institutions ecclésiales et universitaires, s’efforçant d’y faire entendre le point de vue des femmes quelle que soit la résistance en place afin d’actualiser l’égalité entre disciples.
La pensée de Mme Schüssler Fiorenza est accueillie dans son Eglise, du côté des forces d’ouverture postconciliaires. Au fil des éditoriaux qu’elle a signés, depuis 1978, pour la revue Concilium, on a pu suivre cette élaboration d’une nouvelle manière de travailler les thèmes existentiels féminins en théologie, tels que la différence, la nature, la maternité, le statut professionnel. Dans un langage structuré et engagé, le dossier qui traite de la violence envers les femmes reste un des plus impressionnants.
Elle y dévoile la complicité entre la parole théologique traditionnellement liée au patriarcat et la victimisation des femmes et des enfants. En effet, vivre une telle situation crée en elles un dilemme, à savoir le choix entre sortir de l’état de victime et perdre son insertion chrétienne ou, à l’inverse, subir la violence en restant fidèle au Christ souffrant.
La théologie féministe de la libération indique plusieurs solutions, dont la possibilité de réhabiliter les symboles liés à un Dieu libérateur, tel celui de l’Exode, et de Pâques, sorties de situations d’asservissement vers une vie nouvelle. Cette veine sado-masochiste de la diffusion du christianisme a été depuis lors, à plusieurs reprises, dénoncée et contrée, notamment par Dorothée Sölle ( voir portrait 1).
La Sagesse/Sophia retrouve une place. L’étude du début du christianisme a mené Mme Schüssler Fiorenza à reconnaître l’importance de la théologie de la sagesse à cette époque. Elle publie son étude : « Jésus, enfant de Marie et prophète de Sophia ». Elle utilise « Sophia » ce symbole du langage théologique pour réinscrire – avec d’autres - la place du féminin dans la représentation de l’activité ecclésiale présente.
- Ce portrait est le quatrième et dernier portrait de théologiennes du 20 et 21e siècle, qui ont marqué la théologienne romande Michèle Bolli. Vous pouvez lire ou relire sa chronique Y a-t-il une véritable avancée de l’égalité dans les Eglises protestantes aujourd’hui ? ainsi que les trois portraits précédents : Déraciner l’injustice pour retrouver l’égalité, France Quéré : éthicienne de la famille au « féminisme raisonné » et Le cri silencieux : mysticisme et résistance.
Elisabeth Schüssler Fiorenza est née 1938 à Tschanad (Roumanie). Elle est catholique, allemande et mariée. Professeure de théologie et d'études néotestamentaires à la Harvard Divinity School, elle est fondatrice et co-directrice de plusieurs revues, éditorialiste pour la revue Concilium. Elle a été présidente de la Société de Littérature biblique et de l’American Academy of Arts and Sciences.
Quelques publications importantes :
- Bread Not Stone : The Challenge of Feminist Biblical Interpretation, Beacon P., Boston,1984.
- En mémoire d’elle. Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la théologie féministe, Cerf, Paris, 1986.
- Les femmes invisibles dans la théologie et dans l’église, Concilium 202, 1985.
- Justifiée par tous ses enfants. Lutte, mémoire, vision, Concilium 227, 1990.
- La violence envers les femmes, Concilium , 252, 1994.











