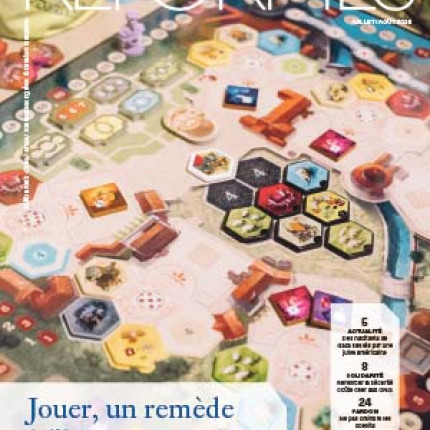Trop d’aide pour l’Afrique ? Alliance Sud dénonce les ratages et indique les progrès possibles
23 novembre 2006
Encourager l’élevage de vaches « n’était pas le bon modèle », admet Peter Niggli, directeur de la communauté d’œuvres actives dans l’aide au développement
Toutefois, la Suisse devra augmenter son aide à 0,5, puis 0,7% du PIB par année d’ici 2015 pour pouvoir tenir ses engagements.Pour ses 35 ans, Alliance Sud, la communauté de travail réunissant Swissaid, Pain pour le prochain, Action de Carême, Helvetas, Caritas et l’Eper se demande si l’Afrique souffre de trop d’aide . Les propos du conseiller fédéral Christoph Blocher vous poussent-ils à cet examen de conscience ?Peter Niggli, directeur d'Alliance Sud : « Nous avons prévu le thème de cette conférence il y a plusieurs mois. Depuis deux ans, la presse alémanique nourrit une polémique sur l’aide au développement. Plusieurs jos_content de la NZZ ont demandé si l’on ne versait pas trop d’aide ou pourquoi elle n’arrivait à rien. Cette polémique s’est développée après la signature par la Suisse de la déclaration du Millénaire, qui a pour objectif de réduire la pauvreté de moitié d’ici 2015 en augmentant l'aide au développement. Et pourtant, au dernier sommet des Nations Unies, la Suisse n’a annoncé aucune augmentation de son aide. Elle a simplement promis de réévaluer la question en 2008. »L’Afrique n’est pas composée que de perdants. Selon un rapport de la Banque mondiale publié fin octobre, un petit nombre de pays enregistrent un taux de croissance annuel de plus de 4,5% depuis le milieu des années 1990 et ont soustrait nombre d’habitants à la pauvreté, grâce au commerce de leurs matières premières et non à l’aide au développement. Ne faudrait-il pas « laisser l’Afrique se débrouiller seule » ?« Jusqu’à la fin de années 1970, l’Afrique a connu un taux de croissance satisfaisant. Puis il y a eu la crise de la dette, la hausse des taux d’intérêts et du coût du pétrole ; cette crise a entraîné une croissance négative sur ce continent. L’aide a été augmentée, et elle a peut-être évité le pire. Maintenant, il y a une forte demande de matières premières, comme le coton, par la Chine et l’Inde. Des pays comme le Sénégal, le Mozambique, le Burkina Faso ou le Cameroun sont revenus à des taux de croissance tout à fait satisfaisants. Mais d’autres n’ont pas résolu les conflits politiques qui minent ces Etats construits artificiellement par les pouvoirs européens. Ce n’est pas réaliste de croire que l’on va laisser l'Afrique se débrouiller seule ; tous les grands pouvoirs du monde veulent accéder à ses ressources naturelles et sont prêts à payer pour la corruption ou pour s’en faire des alliés ».« La Suisse investit 400 millions de francs par an dans des projets précis avec des résultats concrets », affirme Micheline Calmy-Rey. Comment expliquer que les efforts des entreprises africaines continuent à se heurter à une infrastructure routière dépassée, des ports peu efficaces, une pénurie d’énergie ?« On doit relativiser l’importance de ce montant, qui ne représente que 50 centimes pour chaque Africain. La Suisse investit avec succès dans les services sociaux ou les infrastructures rurales pour l’approvisionnement en eau. Mais elle n’investit pas dans de grandes infrastructures qui permettraient à ces pays de commercer entre eux. C’est un projet à discuter si l’on parle d’augmenter l’aide. Deuxièmement, l’Afrique doit produire quelque chose de compétitif à acheter, et là, elle souffre parce que le continent est inondé de produits subventionnés par l’Union européenne. Il faudrait des conditions préférentielles pour que la production de coton de l’Afrique sahélienne, compétitif internationalement, ait une chance ».La Norvège vient d’annuler une dette de 63 millions d’euros parce qu’elle reconnaît sa coresponsabilité en tant que créditeur du prêt octroyé pour « une politique de développement ratée, aux besoins mal évalués et aux risques mal analysés ». Un modèle pour la Suisse ?« C’est vrai, il y a eu beaucoup de projets mal planifiés ou non adaptés aux conditions. On a par exemple poussé une agriculture d’élevage de bovins suisses, qui ne supportaient pas le climat, ou la reforestation avec des plantes qui n'étaient pas indigènes. Ce n’était pas le bon modèle. La Suisse n'est pas la seule à avoir fait des erreurs. Dans les années 70, plusieurs agences d’aide au développement ont investi dans l’industrie lourde en installant une forge au Nigéria. Cela n’a jamais fonctionné car on n’avait pas le savoir-faire, juste l’outil flambant neuf. Depuis longtemps l’aide au développement ne soutient plus d’entreprise individuelle. Maintenant, la Suisse a été le premier pays à désendetter les pays les plus pauvres, avec un crédit de 500 millions en 1992. Elle a toujours investi des donations et non des prêts, et ne peut donc suivre le modèle norvégien, mais l’idée est intéressante. »Partagez-vous l’avis d’Andreas Gross (PS/ZH), selon lequel la Suisse devrait s’inspirer des pays scandinaves ou du Luxembourg qui consacrent près de 1% de leur PIB à la coopération au développement (la Suisse se limite à 0,4%) ?« Il y a aide et aide. Dans les 50 dernières années, une grande partie de l’aide a été politique, pour se faire des amis de ces pays et sans but de développement. La France, les USA, le Japon donnent près de la moitié de l’aide totale et beaucoup de cette aide est politique. Il faut la dénoncer publiquement ; mais cela ne concerne pas vraiment la Suisse qui, avec le Luxembourg ou la Hollande, a suivi une aide au développement non influencée par des intérêts géopolitiques. La Suisse a aussi beaucoup réduit son « aide liée », qui consiste à aider un pays à s’équiper en l’obligeant à se fournir auprès d’entreprises suisses ; elle ne représente plus que 4% de l'aide helvétique. En outre, elle utilise désormais le soutien d’experts africains aux côtés d’experts suisses bien payés dans ses projets de coopération, ce qu’elle ne faisait pas il y a 20 ans. Il faut poursuivre ces progrès. Mais la Suisse doit suivre la décision de l’Union européenne d’augmenter l’aide véritable à 0,56% du PIB en 2010, puis 0,7% en 2015. A terme, le 0,4% actuel sera insuffisant car il comprend aussi le coût d’accueil des requérants d’asile, un argent qui n’a pas d’effet sur la situation intérieure de l’Afrique. »