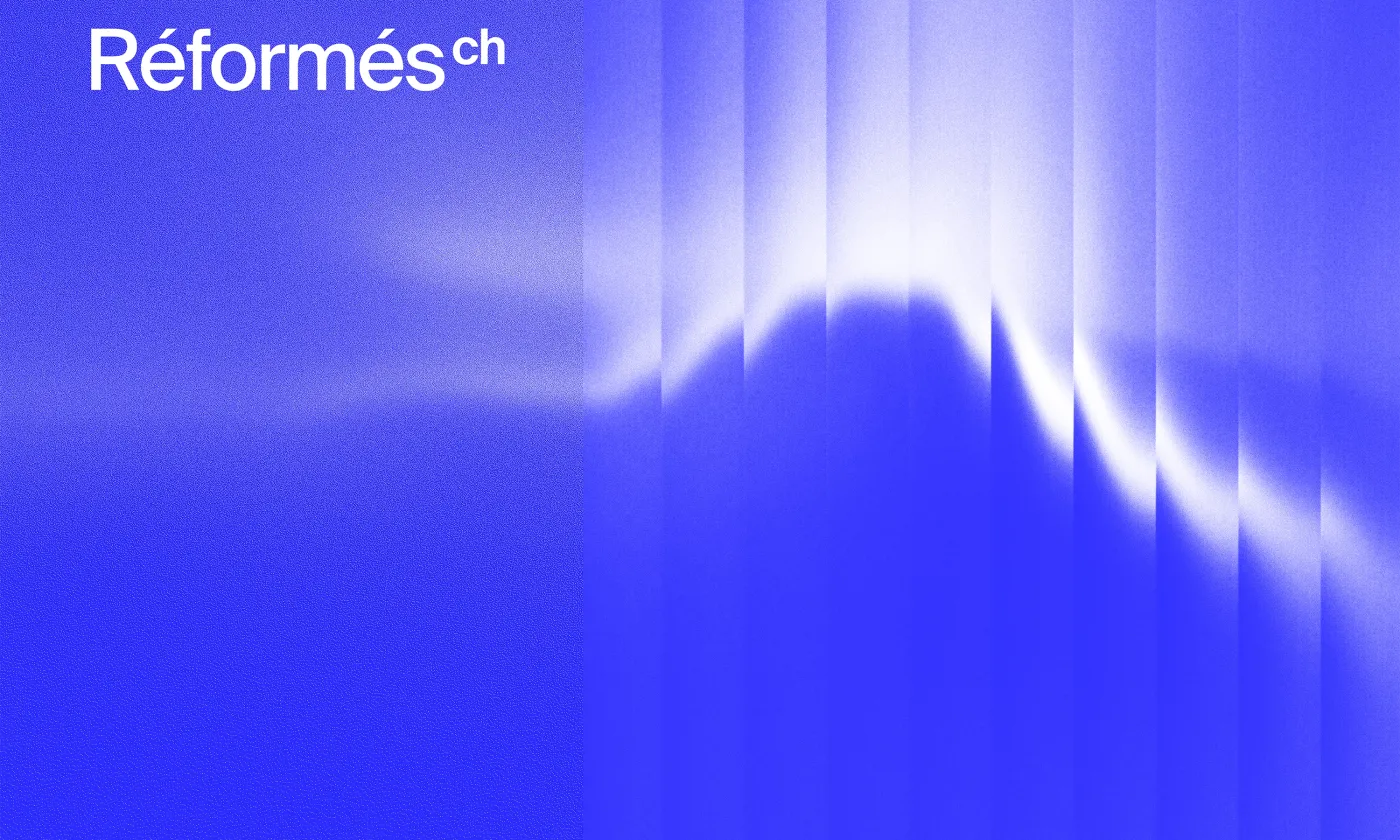
La splendide Bible Atlantique de Genève témoigne d’une profonde réforme de la chrétienté au Xlème siècle
La Bibliothèque universitaire de Genève détient une superbe bible du XIème siècle
C’est tout le talent de Nadia Togni d’avoir su identifier différents scribes au fil de son travail de thèse. Il lui a fallu étudier les infimes variations d’une graphie à une autre, dans un ensemble pourtant très standardisé. « A la fin, on devient copain avec les copistes, dit-elle en riant. On finit par s’intégrer au processus de production ». Nadia Togni, qui a aussi travaillé sur une bible identique à Dubrovnik (HR), y a repéré certains copistes qui étaient les mêmes que ceux ayant travaillé sur la Bible de Genève.
Un des autres intérêt de cet ouvrage est qu’il parle de la pratique liturgique en usage alors à Genève. Des annotations que l’on peut trouver au hasard des pages révèlent au chercheur l’utilisation qui a été faite de ce splendide volume lors des offices. Certaines références renvoient à d’autres ouvrages de la bibliothèque des chanoines. Par ailleurs, une riche décoration, là encore très standardisée, rehausse l’ensemble. Un tournant dans l’histoire de la chrétienté Le véritable intérêt de ces ouvrages est ce qu’ils nous disent des profonds changements du temps. Le XIème siècle , époque à laquelle ils sont réalisés, est un tournant dans l’histoire de la chrétienté : « Jusque-là, raconte le Pr. Michel Grandjean, qui a supervisé le travail de recherche , les papes étaient au mieux des aumôniers de l’Empereur. Certains étaient assassinés. Certains étaient chassés de Rome. Ils n’avaient aucune autorité. Or, la création de ces bibles révèle une volonté de reprise en main de la chrétienté par les papes, particulièrement de Léon IX. Désormais, c’est un collège de cardinaux – et non plus l’Empereur – qui choisit le pape, comme cela se fait encore aujourd’hui. » Les évêques sont nommés par Rome contrairement à la pratique qui prévalait jusque là.
C’est ce qu’il est convenu d’appeler la réforme grégorienne, par référence à Grégoire VII (1073-1085), qui tint tête à l’Empereur au point que celui-ci vint en 1077, pieds nus, s’incliner devant lui dans son château de Canossa – d’où l’expression populaire aller à Canossa qui signifie capituler. Cette réforme sera largement relayée par l’ordre de Cluny, dont les abbayes s’implantent un peu partout alors en Europe. Diffuser le même message
La réalisation des Bibles Atlantiques est un autre volet de la montée de ce pouvoir ecclésiastique. Les papes veulent qu’un peu partout en Europe on s’appuie sur les mêmes références. D’où une composition particulière de ce texte, notamment dans l’ordre des livres. « Elle se termine par les épitres de Paul, relève Nadia Togni, ce qui est une manière de suggérer que le pape est un des successeurs des apôtres. »
Nadia Togni est en quelque sorte la représentante suisse d’une discrète internationale de chercheurs qui s’est mise au travail un peu partout en l’an 2000, pour le bimillénaire du Christ. La pierre qu’elle apporte à cet édifice participe à évaluer ce qui reste de ce trésor.
Un témoin catégorie poids lourd
La Bible atlantique de Genève fut donnée vers 1050 au chapitre des chanoines de Genève par l’évêque Frederic (1031-1073). Elle est soigneusement gardée dans les réserves de manuscrit de la Bibliothèque universitaire. Dans la nomenclature elle est connue sous le numéro 1 du fonds des manuscrits latins. On l’a fait reposer sur des mousses en plastique pour qu’elle ne s’endommage pas à la manipulation. L’autre exemplaire suisse fut apporté à Sion par l’évêque Ermenfroi (1055-1082).
Gigantesques d’abord par leur format, les Bibles atlantiques sont composées de feuillets, en parchemin de chèvre. L’ouvrage de Genève mesure 600 mm de haut pour 400 mm de large, sa hauteur est donc le double d’une page A4 moderne. Elle compte 417 pages et a nécessité la peau d’une centaine de chèvres pour sa réalisation. Son poids de 23 kilos est ce qui l’a sauvée : lors du passage de la ville à la Réforme, elle était trop lourde pour que les moines en fuite ne l’emportent.











