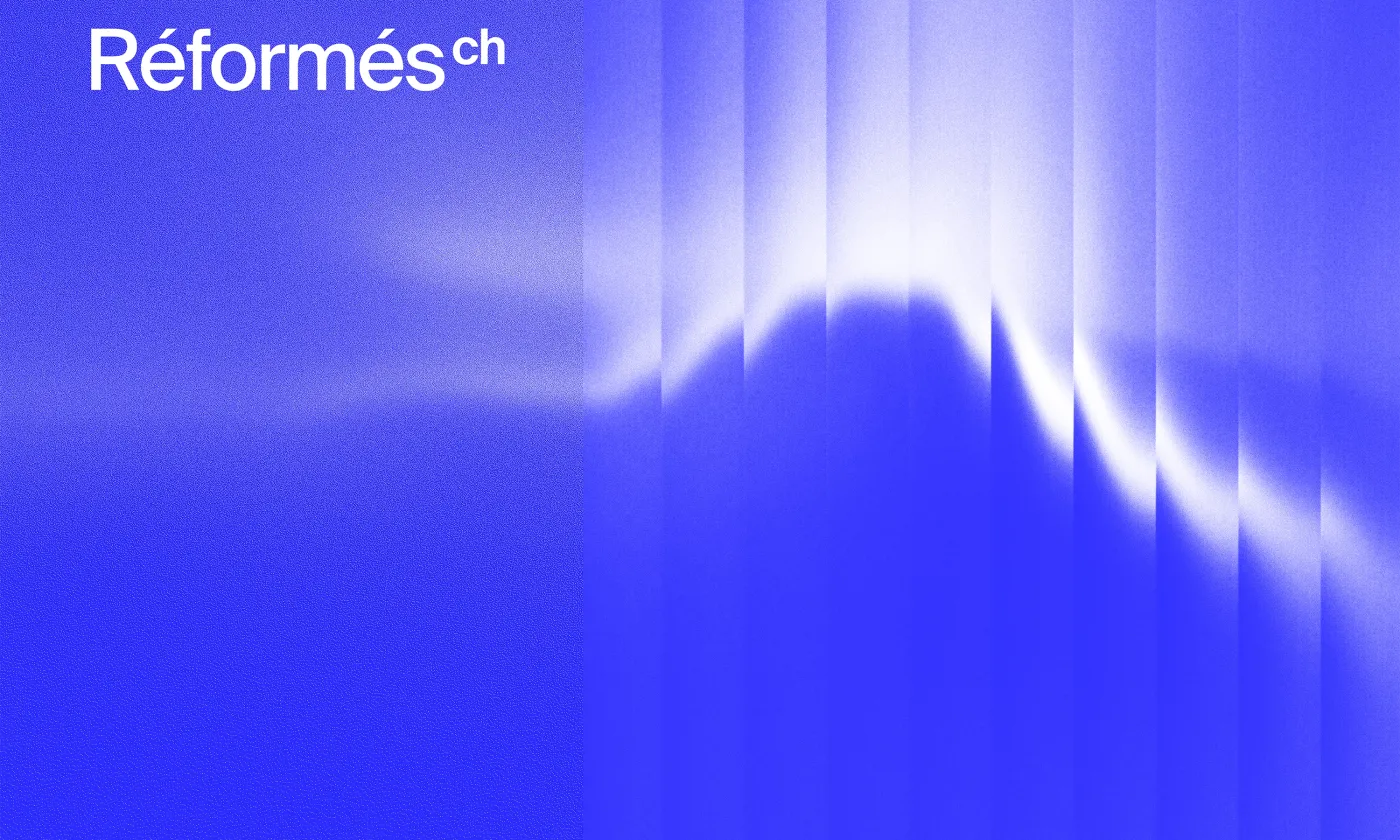
Alexandre Jollien: un chemin de libération
Par Sylvain Stauffer
Dans ce livre, vous introduisez la notion de reddition. Que voulez-vous dire ?
Alexandre Jollien : De par ma vie, j’ai été habitué à lutter, à combattre, à progresser jusqu’au risque de l’épuisement. Les passions, ce qui est plus fort que moi, m’ont montré que même avec la meilleure volonté du monde, il y avait des obstacles infranchissables. La reddition c’est, par exemple, par rapport à la colère, l’accepter, la laisser passer. Au fond, c’est tout sauf un passage à l’acte, c’est laisser naître et mourir sans s’attarder, sans se crisper sur ce qui nous résiste.
Il ne faut donc pas lutter contre les passions ?
A. J. : J'ai longtemps cru que la véritable sagesse consistait à purger du cœur tout ce qui est plus fort que la raison. Et que le sage était débarrassé totalement de toute ombre de colère, de jalousie ou de convoitise, qu’il était en gros inébranlable. Je pense aujourd’hui au contraire que le véritable détachement est celui du cœur qui se laisse traverser par l’émotion sans que celle-ci ne le tyrannise.
Le Christ en cela nous montre un exemple: il pleure devant la mort de Lazare, mais ce n’est pas une tristesse égocentrique. Notre cœur pourrait d’une certaine manière accueillir tout ce qui nous touche avec bienveillance, sans que cela ne nous rende aigres ni amers. A trop vouloir lutter contre la passion, on s’épuise.
Là, l’image de La Fontaine s’impose: le roseau plie mais ne rompt pas. A l’endroit de la passion, la même posture est peut-être requise. Ce qui nous rend humains, c’est se laisser traverser par nos sentiments. Ce qui nous rend tyranniques, c’est se raidir sur nos émotions.
Ce nouvel opus marque-t-il dans votre œuvre un tournant, de la philosophie à la spiritualité?
A. J. : Oui, et ce sont les passions qui m’y ont amené, ou plutôt ramené. Il me semble que la philosophie sollicite avant tout la raison, la volonté, l’effort. La spiritualité et, avant tout pour moi le christianisme, réclame pour sa part une conversion de tout l’être et nécessite un saut dans la foi, dans l’abandon. D’autre part, j’ai toujours voulu taire ma foi ou du moins rester discret à son sujet, alors qu’elle fait partie de moi et qu’elle s’épanouit toujours davantage.
Comment vivez-vous votre foi au quotidien ?
A. J. : Pour moi, la foi dans le Christ est d’abord une exigence, un saut dans la confiance. Pour moi, le grand exercice spirituel, c’est être à l’écoute, prendre du temps dans la journée pour revenir à l’intériorité et écouter le calme et la douceur qui résident au fond du fond. La foi, c’est aussi l’exigence que Dieu passe par l’autre.
L’écoute et le respect de l’autre sont donc un moyen de la vivre. Bien sûr, je suis toujours en deçà de cette exigence, mais vivre la foi, c’est se remettre en route chaque jour. Comme disait Kierkegaard, on n’est jamais chrétien, on y tend toujours davantage. Seul le Christ est vraiment chrétien. La foi au quotidien, c’est cet itinéraire de chaque instant.
Qu’est-ce que Jésus représente pour vous ?
A. J. : Une voie à suivre plus qu’un modèle à imiter. Car il est inimitable. Contrairement aux sages stoïciens, il reste un homme sensible à la souffrance de l’autre et il montre tout le contraire de l’indifférence. Il est plutôt dans le détachement, détaché par rapport à lui, détaché à l’endroit de son sort, mais jamais indifférent à l’égard de l’autre. En ce sens, être son disciple, c’est se détacher de soi, porter sa croix et aller à sa suite, comme le disent les Evangiles.
Dans votre livre, vous évoquez votre pratique du zen. Comment en êtes-vous venu à cette forme de méditation ?
A. J. : Ma femme pratiquait le zen et j’étais toujours sceptique. Lorsqu’une fois nous avons assisté à une initiation au zazen, j’ai soudain réalisé dans une fulgurance la beauté du corps et l’expérience de la gratuité. Depuis lors, je n’ai jamais cessé de pratiquer le zen quotidiennement. C’est une voie vers l’intériorité, un hymne au présent et au fond, à la sacralité de chaque chose de la vie.
Comment concilier zen et christianisme ?
A. J. : Le zen est la voie du silence, une voie apophatique (ndlr: qui ne peut être que vraie ou fausse). C’est une démarche de purification qui me vide d’un trop-plein conceptuel et de toutes les étiquettes qu’on pose sur Dieu. Le zen, en ce sens, m’a ramené au christianisme. Si l’on écoute ce qui se trame au fond du fond, on peut y trouver Dieu. J’ai beaucoup cherché un moyen pour prier jusqu’à m’apercevoir que la prière était avant tout l’écoute et, précisément, la reddition dans le silence.
« La mort à soi », dont vous parlez à plusieurs reprises dans le livre, est-elle aussi un point commun entre ces deux traditions spirituelles ?
A. J. : Le zen propose de passer par la grande mort pour accéder à la vie, à savoir quitter l’ego. Le Christ et sa croix nous indiquent un chemin. Jésus n’est jamais préoccupé par lui. A ses disciples qui lui demandent comment le suivre, il leur dit de renoncer à eux-mêmes.
Rien de mortifère dans cette invitation: c’est une fois qu’on a renoncé à son petit soi, qu’on s’ouvre à la grandeur de l’homme. Je suis fasciné de voir combien ces deux traditions spirituelles se rejoignent malgré des différences. C’est toujours une invitation à dépasser l’égoïsme pour exister véritablement.
N’y a-t-il pas un risque de syncrétisme ?
A. J. : D’où l’intérêt d’approfondir ses racines et de creuser à fond une religion. Il y a un risque certain de faire ses courses au marché de la spiritualité. La méditation est aujourd’hui une grande mode qui, malheureusement, relève souvent de la caricature comme le fameux « Soyez zen! ».
Cependant, un dialogue authentique entre la personne du Bouddha et celle du Christ peut révéler la singularité de chacun et nous oblige à quitter une approche qui exclut l’autre. Pratiquer le zen, dans ce sens, c’est ni l’instrumentaliser, ni le réduire à une cure de bien-être, mais c’est suivre une voie qui nous amène au-delà des mots, vers le fond du fond, où le chrétien peut retrouver le Christ.
- Alexandre Jollien, Le philosophe nu, Ed. du Seuil, 2010
Du même auteur : - Eloge de la faiblesse, Cerf, 1999
- Le Métier d’homme, Seuil, 2002
- La Construction de soi, Seuil 2006.
- Le site d'Alexandre Jollien
Cet article a été publié dans :
L'hebdomadaire catholique Echo Magazine.











