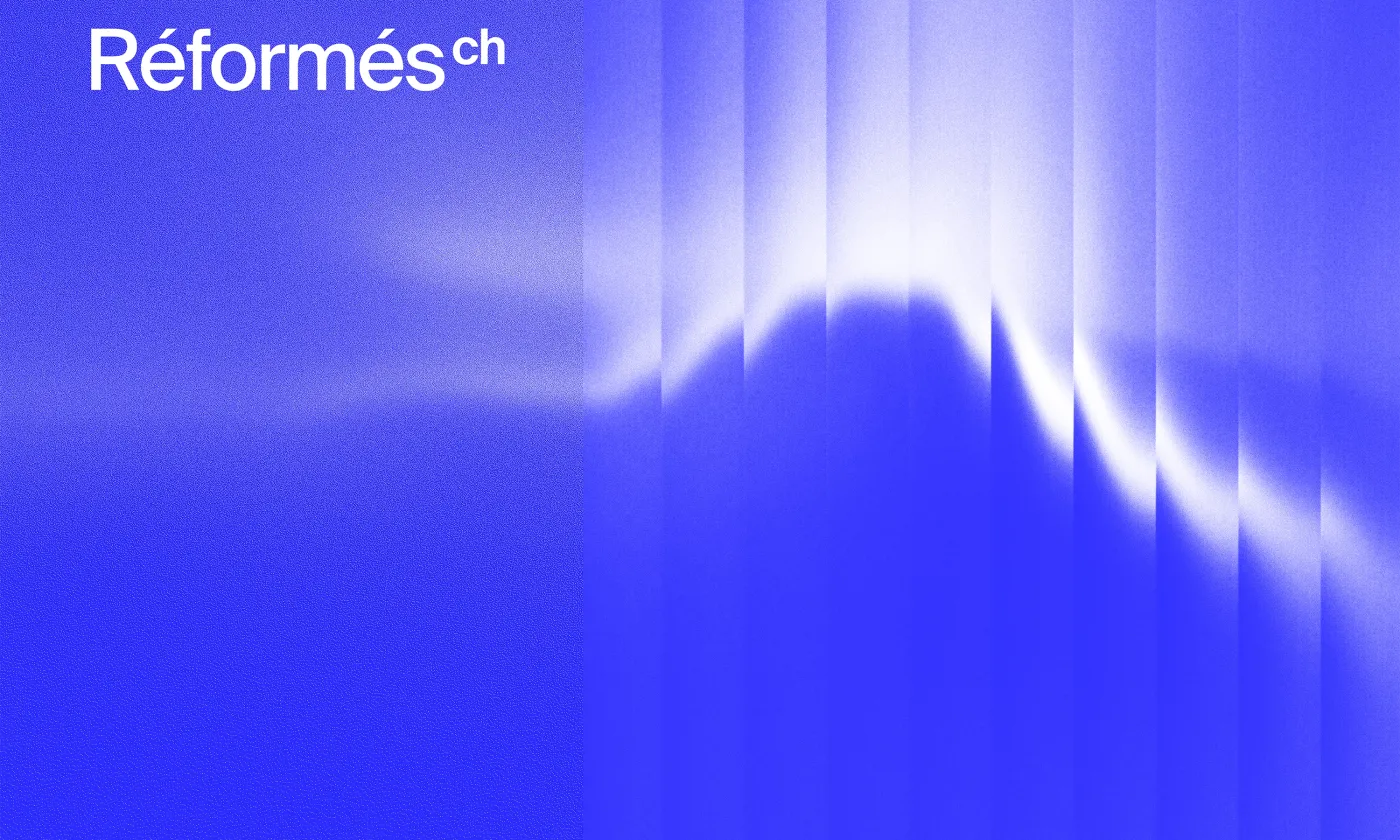
COE : Comment s'adapter à un monde religieux en constante évolution ?
« S'il en est incapable, un travail portant uniquement sur la gouvernance interne et la survie institutionnelle pourrait absorber toutes les forces du mouvement œcuménique », a relevé un délégué pendant les débats. Le Comité central du COE a consacré deux séances plénières aux « mutations dans le paysage ecclésial et œcuménique » et aux « relations et la coopération interreligieuses ».
« Au Sri Lanka, quatre religions principales interagissent : le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et le christianisme. Il existe une empreinte ancienne sur une montagne que les quatre religions revendiquent. Les chrétiens disent que c'est l'empreinte d'Adam », a expliqué le pasteur méthodiste Ebenezer Joseph. Mais nous ne nous battons pas pour la montagne, tout se fait de façon pacifique. Les relations interreligieuses sont solides, car le dialogue entre les communautés est sain », a souligné le pasteur Joseph.
Les relations interreligieuses pacifiques peuvent néanmoins être perturbées, même dans des zones où la cohabitation s'est historiquement faite sans heurts.
Les Eglises chrétiennes d'Indonésie « travaillent côte à côte avec différentes communautés religieuses », a indiqué la pasteure Margaretha Hendriks-Ririmasse, de l'Eglise presbytérienne des Moluques. « En général, nous ne sommes pas confrontés à de graves conflits dans le cadre de ces relations, même si certains préjugés subsistent. »
Mais elle a ajouté que les relations interreligieuses se sont détériorées en Indonésie à la suite de la « guerre contre la terreur » appuyée par les États-Unis. « En effet, le christianisme est considéré comme un agent des Etats-Unis et de l’Occident, de sorte que des groupes musulmans extrémistes se sont constitués. On assiste à des agressions toujours plus nombreuses contre des chrétiens et des églises. »
Mais parallèlement, les chrétiens ont reçu un soutien important de la part de la communauté musulmane indonésienne, en majorité modérée. « Les musulmans nous ont manifesté leur soutien par des déclarations vigoureuses lorsque nous étions attaqués », a-t-elle précisé.
Les relations entre les catholiques et le COE se sont aussi transformées au cours des cinquante dernières années, selon le père Gosbert Byamungu du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et co-président du Groupe mixte de travail de l'Eglise catholique romaine et du COE. « La méfiance et l’animosité ont fait place à la confiance et à l’amitié. Maintenant, il s’agit pour nous de transformer les accords de doctrine en témoignage et service communs ».
Face aux nombreux défis de la mondialisation, l'archevêque Nareg Alemezian, de l'Eglise apostolique orthodoxe arménienne au Liban, a appelé à l'unité visible de l'Eglise dans le cadre des ministères auprès des migrants, de la mission et des relations interreligieuses.
Pour la pasteure Jennifer S. Leath, de l'Eglise méthodiste épiscopale africaine des Etats-Unis, le COE devra changer en profondeur. Comme le christianisme s'est développé de façon exponentielle dans les pays du Sud tout en déclinant dans l'hémisphère nord, elle s'est demandée si le COE acceptera le transfert de pouvoir et d'influence qu'implique ce changement.
En Allemagne, un programme lancé dans les écoles publiques locales et intitulé « Sais-tu qui je suis ? » suscite un dialogue sain entre élèves chrétiens, musulmans et juifs. Mais Christina Biere, de l'Eglise évangélique d'Allemagne, déplore que les « efforts de ce genre dans les Eglises locales » soient trop peu nombreux.
Christina Biere a expliqué que même dans des pays stables comme le sien, l'évolution du contexte pose problème. Citant une enquête récente de l'Université de Münster, elle a fait observer que les Allemands « sont moins tolérants que leurs voisins européens à l'égard des musulmans ».
Christina Biere a attribué la coloration religieuse du débat sur l'immigration à la rareté du dialogue interreligieux dans son pays, en ajoutant : « Contrairement à nos voisins, nous n'avons pas eu de débat honnête et approfondi sur les musulmans et l'immigration ».
Selon l'archevêque Alemezian, la réussite des relations œcuméniques et du dialogue interreligieux – de même que la survie du COE – dépend, de la capacité des membres des Eglises à « vivre la communion fraternelle du COE par delà le seul cadre de l'institution ».











