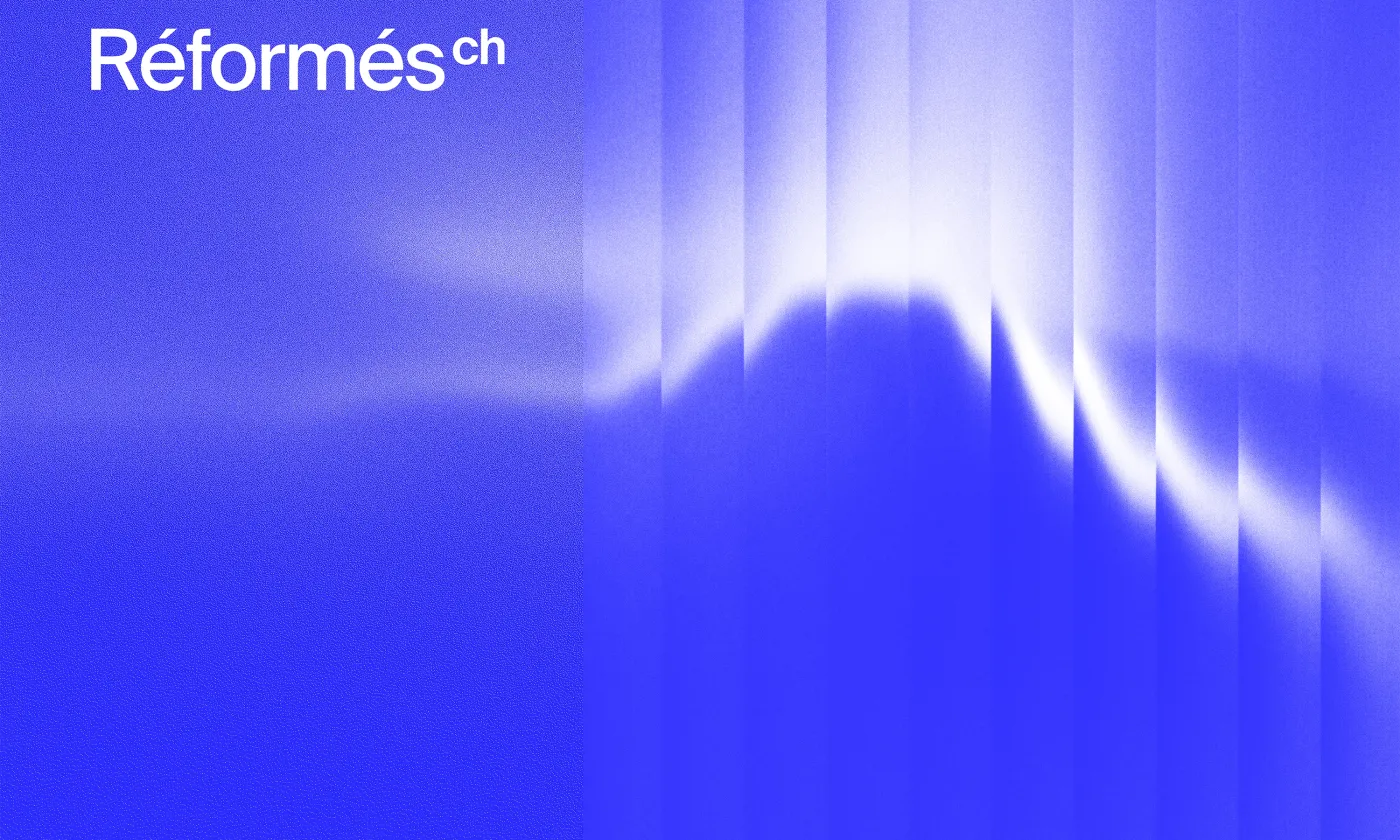
Le cri silencieux : mysticisme et résistance
*
Jeune femme au milieu des souffrances consécutives au conflit armé qui vient de se dérouler, elle refuse la passivité qu'elle voit se développer partout et jusque dans le christianisme. Elle proposa alors des veillées de prière, s’appuyant à la fois sur la force de la vie communautaire et sur la confiance dans la prière. Plus tard, elle thématisera le chemin de guérison que participantes et participants ont pu suivre pour sortir de l’état de silence et d’isolement produits par la souffrance. Contre l’exclusion
Interroger la théologie, en particulier à partir de la philosophie, caractérise sa démarche. Dorothee Sölle dénoncera l’exclusion des nombreuses personnes qui ne correspondent pas au modèle idéal de l’être humain alors en vigueur, soit un homme blanc, jeune, blond, riche… Son genre la place parmi les exclues et les exclus, avec les noirs, les pauvres et les handicapés.
Cet état de fait social se retrouve dans la religion, la théologienne remarque que « Les pères de la foi sont redoublés dans le Père des cieux ; les mères de la foi sont dans l’obscurité ; elles restent dans la préhistoire, non remémorées, oubliées, refoulées ». Elle met ainsi le doigt sur un déséquilibre du christianisme. Elle se rapprochera du courant de la théologie de la libération, qui lit le sens du message de l’Evangile à partir de situations d’exclusion.
Philologue et germaniste, elle fera également une critique des usages langagiers en vigueur en théologie abordant ce point crucial : la notion de paternité de Dieu. Dans un texte intitulé « Père, puissance et barbarie. Questions féministes à la religion autoritaire », elle aborde la question de la dépendance / indépendance dans laquelle se situe toute vie humaine. Dépendance religieuse, dépendance politique aussi.
Tout chrétien apprend très jeune à prier « Notre Père » comme Jésus l’a enseigné. Or, dans la culture allemande avant la guerre déjà, la puissance paternelle était très fortement mise en valeur. Mais, elle a été exacerbée, puis détournée pour devenir toute-puissance dans sa version nazie.
Dorothee Sölle fera la critique de cette collusion entre puissance paternelle et barbarie, a fortiori lorsque cette forme de puissance paternelle a été liée à une certaine compréhension de Dieu, qui s'est reflétée dans les pratiques d’une partie importante de l’Eglise allemande durant la guerre.
Mme Sölle désignera du terme de « christofascisme » cette idéologie. Sans doute pour s’en démarquer définitivement, elle se déclara mystique, rejoignant ainsi cette veine qui court tout au long de l’histoire du christianisme, comme un lieu d’interpellation de ses formes institutionnalisées plus ou moins fidèles.
La théologienne allemande exprime ainsi ses questions à l’obéissance requise envers un Père puissant. Elle se demande d'abord si l’obéissance a suscité et codéterminé une « civilisation » - et pas plutôt une barbarie ? Elle écrit : « Ma première question à une "civilisation chrétienne de l’obéissance" est donc celle-ci : l’obéissance n’est-elle pas justement l’un de ces concepts qui ne peuvent plus devenir sains après l’Holocauste? »
Deuxièmement, le mot « père » peut-il encore être appliqué à Dieu maintenant que nous avons appris à penser ensemble Dieu et la libération ? Et troisièmement, à quels symboles du père est-il impossible de renoncer ? L’expression de Dieu père des vivants n’exprime-t-elle pas justement une dépendance positive en tant que liaison entre les vivants ? » dira-t-elle au final.
Mme Sölle redécouvre ainsi une notion de paternité comme « puissance génératrice de vie ». Au-delà de cette situation précise, sa critique rejoint la souffrance de nombreuses femmes opprimées, discriminées, au nom d’un Dieu père.
La théologienne poursuivra sa réflexion sur le langage en usage et cela l’amènera à exprimer une compréhension de Dieu encore peu usitée « Dieu est « notre mère, écrit-elle en 1988, qui pleure sur ce que nous nous faisons subir les uns aux autres (...) et aux animaux et aux plantes. Dieu nous console comme une mère sait le faire… ».
Proche des mystiques, qui ne se privent pas d’user du féminin pour parler de la vie de Dieu, ou encore d’éprouver en eux-mêmes les souffrances d’autrui, elle apprécie les audaces langagières et existentielles. Elle dira par exemple « La communion dans la douleur de Dieu notre Mère avec les souffrants vient de la communion d’amour à laquelle nous sommes tous appelés ».
« Je crois en Dieu qui veut la transformation de toutes les situations par notre travail, par notre activité politique et culturelle », dit-elle encore. Elle voyagea aux USA et participa aux marches de protestation contre de nombreuses guerres, celles du Vietnam, la guerre froide, guerre du Golf, le conflit afghan ou iraquien, donnant corps à ses mots « Je crois en la possibilité de construire une paix juste » a affrimé Dorothee Sölle après avoir prié publiquement ainsi : « J’ai eu faim et vous avez détruit chimiquement les récoltes de mon pays. J’étais nu et vous m’avez habillé de napalm ».
On lit des traces de rencontres marquantes, dans son best-seller intitulé Souffrances. Cette protestante se situe en fille de Luther qui, comme elle le souligne, avait placé la croix et la souffrance au centre de sa théologie parce que c’est exactement le lieu où Dieu agit avec l’humanité. Elle désamorce le masochisme chrétien qui s’était beaucoup développé ainsi que les représentations d’un Dieu sadique qui l’accompagnent et en analyse subtilement les causes.
On voit donc, par ce bref portrait, que la pensée de Dorothee Sölle rejoint la question de l'égalité touchant à la place de la croyante, du croyant. S’inscrivant à la suite de Jésus-Christ, la théologie de Dorothee Sölle traduit le souci de l’inclusion, la compassion envers la souffrante, le souffrant, revient sur le soutien qu’il et elle peut recevoir de la communauté et n'oublie pas la critique du langage qui, s'il dévoie le sens, peut se transformer en instrument d’oppression. Réaliste et engagée, elle termine son credo par ces mots : « Je crois à l’avenir de ce monde qui est le monde de Dieu ».
- Portraits de théologiennes : La théologienne romande Michèle Bolli brosse le portrait de quatre théologiennes, qui ont agi sur l’histoire pour que le christianisme se rapproche de la justice envers les femmes. Le portrait de Dorothee Sölle est le premier. Suivront ceux de France Quéré, Kari E. Börresen et E. Schüsser Fiorenza. rendez-vous vendredi prochain.
- Lire la chronique de Michèle Bolli : Y a-t-il une véritable avancée de l'égalité dans les Eglises protestantes aujourd'hui ?
Dorothee Sölle est née le 30 septembre 1929, à Cologne dans les milieux de la haute bourgeoisie et de l’intelligentsia allemande. Elle a étudié la théologie, la philosophie et la littérature à Cologne, Fribourg et Göttingen. Entre 1968 et 1972, elle a participé activement à la vie et au débat politique, prenant position contre les guerres.
Puis, elle a partagé son temps entre l’Allemagne et les USA après avoir obtenu, en 1975, la chaire de théologie systématique à l’Union Theological Seminary de New York. Elle a publié de nombreux textes théoriques, méditatifs et poétiques. Elle n'a jamais été professeure en Allemagne, mais a reçu un doctorat honoris causa de l’Université de Hambourg en 1994. Elle meurt au cours d'un congrès, en Allemagne, le 27 avril 2003.
- « Père, Puissance et barbarie » Questions féministes à la religion autoritaire » publié dans la revue Concilium 163, 1981, pp 105-113.
- « Libérer notre parler de Dieu », Conférence UNIL, Lausanne, 1992
- Souffrances, Cerf, Paris, 1982, plusieurs rééditions.
- Against the Wind: Memoir of a Radical Christian, 1999. Son autobiographie.
- The Silent Cry : Mysticism and Resistance, 2001











