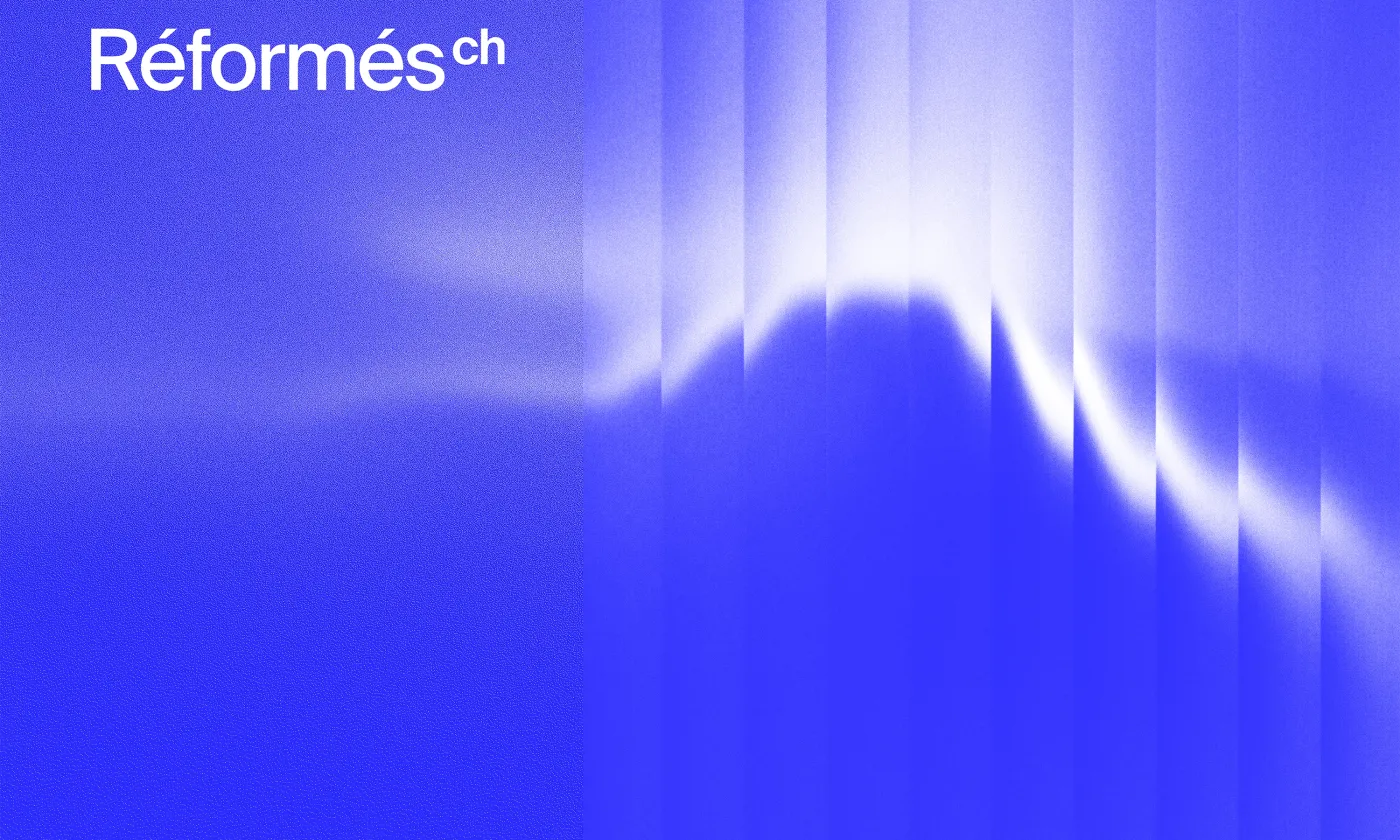
Déraciner l’injustice pour retrouver l’égalité
Par Michèle Bolli*
La théologienne raconte, dans un article paru dans la revue Concilium en 1981, ce qui l’a mobilisée pour une tâche de recherche scientifique sur certains textes fondamentaux du christianisme. « J’avais dix ans quand ma mère est devenue catholique (…) Je n’ai donc pas subi la socialisation de type patriarcal qui est courante chez les filles issues de milieux catholiques traditionnels.
Venant en France en 1951, j’ai éprouvé un choc culturel : je me trouvais confrontée avec des femmes qui, selon moi, avaient une image négative d’elles-mêmes. Petit à petit, j’ai compris que cette attitude correspondait à l’enseignement et aux institutions foncièrement androcentriques de l’église catholique romaine. Pour faire la lumière sur cet enseignement et l’influence qu’il exerce, j’ai entrepris mes recherches en anthropologie théologique dès 1961, donc avant le concile Vatican II et bien avant que les Women’s Studies et la Feminist Theology soient à l’ordre du jour ». Elle va chercher à dévoiler les racines de la misogynie et de l’injustice, véhiculées et diffusées par un certain christianisme.
Dans le but d’obtention un doctorat, Kari E. Börresen mène une première et importante étude, intitulée « Subordination et équivalence. Nature et rôle de la femme d’après Augustin et Thomas d’Aquin ». Elle y déconstruit les arguments sur lesquels s’appuie la hiérarchisation des genres, chez ces deux grands théologiens. Ils la comprenaient comme expression d’une nature différente et voulue ainsi par Dieu.
Cette notion de « nature », telle qu’elle fut comprise dans l’Antiquité, est aujourd’hui obsolète sur biens des points. Cependant, ces idées, véhiculées en même temps que l’enseignement théologique traditionnel, ont contribué largement à forger la place inférieure des femmes dans les mentalités, et à renforcer, dans l’esprit des clercs au moins, la légitimité de leur position dominante. Il s’agit là d’une orientation spirituelle qui se trouve en désaccord avec la pratique novatrice de Jésus, qui lui, a justement accepté que des disciples femmes se forment en le suivant.
Le travail de déconstruction de cette forme d’anthropologie chrétienne, qu’effectue Mme Börresen, s’inscrit dans un mouvement plus large. On assiste en effet, dans le champ de la philosophie française, à des publications qui analysent le fonctionnement androcentrique de la culture occidentale (voir les travaux d’Hélène Cixous, de Luce Irigaray, etc.). Quant au versant social de la situation de la femme, il est gagné par la revendication du droit à la contraception et à l’avortement pour réguler la fécondité humaine.
La théologienne nourvégienne poursuit ses travaux d’anthropologie théologique par l’étude de la notion d’image de Dieu, questionnant son attribution au seul genre masculin. Elle juge que si cette manière de hiérarchiser les genres pouvait se comprendre dans une société androcentrique, elle n’a plus de pertinence dans une société anthropocentrique, soit centrée sur l’être humain, homme et femme.
La situation actuelle requiert de parler de Dieu de manière inclusive, en usant des deux genres comme symboles. Elle a cherché, dans l’histoire, des modèles de cette forme de langage, et en a trouvé traces à deux époques différentes. D’une part, chez certains Pères de l’Eglise. D’autre part, dans les textes d’une recluse mystique anglaise du XIVe siècle, Julienne de Norwich, dont le langage annonce prophétiquement les recherches théologiques et langagières du XXe siècle.
Invitée par l’Association Européenne des Femmes pour la Recherche en Théologie, en 2006, Kari E. Börresen désignera par l’expression Réforme matristique du christianisme ce mouvement de déconstruction /restructuration du système de genre dont, par ses travaux, elle a été l’une des initiatrices, et qui se poursuit.
*Il s'agit du troisième portrait de théologiennes, rédigé par la théologienne romande Michèle Bolli à la demande de ProtestInfo à l'occasion du 14 juin. Vous pouvez découvrir ou relire la chronique concoctée par Mme Bolli à cette occasion : Y a-t-il une véritable avancée de l’égalité dans les Eglises protestantes aujourd’hui ? ainsi que le deux premiers portraits : Le cri silencieux : mysticisme et résistance et France Quéré : éthicienne de la famille au « féminisme raisonné ».
- Kari E. Börresen est née à Oslo le 16 octobre 1932. Magister Artium en histoire des idées, en 1960, puis docteure en philosophie en 1968 à l'Université d’Oslo, elle poursuit ses recherches à Paris, Rome et Oxford. Elle enseigne dans plusieurs universités, comme à Rome de 1977 à 1979, puis, en 1981, elle occupe la chaire œcuménique à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Genève.
De 1982 à 2000, elle est professeure de recherche du Ministère de la Culture de Norvège, puis de 2000 à 2002, professeure en histoire théologique et études genres à Oslo. Docteure Honoris Causa de l’Université d’Uppsala, elle a coordonné plusieurs projets en études genre et religion et en religion, genre et droits humains en Europe. Elle est senior professeure d’histoire de l’Eglise à l’Université d’Oslo depuis 2003.
Elle a écrit :
- Subordination et Équivalence. Nature et rôle de la femme d'après Augustin et Thomas d'Aquin, Oslo, Paris, 1968.
- Fondements anthropologiques de la relation entre l’homme et la femme dans la théologie classique, Concilium 111,1976. Voir aussi le no 166, 1981, pour l’article cité dans le texte ci-dessus.
- Image of God and Gender Models in Judaeo-Christian Tradition, Minneapolis, Fortress P., 1991.
- Christine, reine de Suède : autonomie et foi rationnelle, Annuaire de l’AFERT, 2007, p.163ss.











