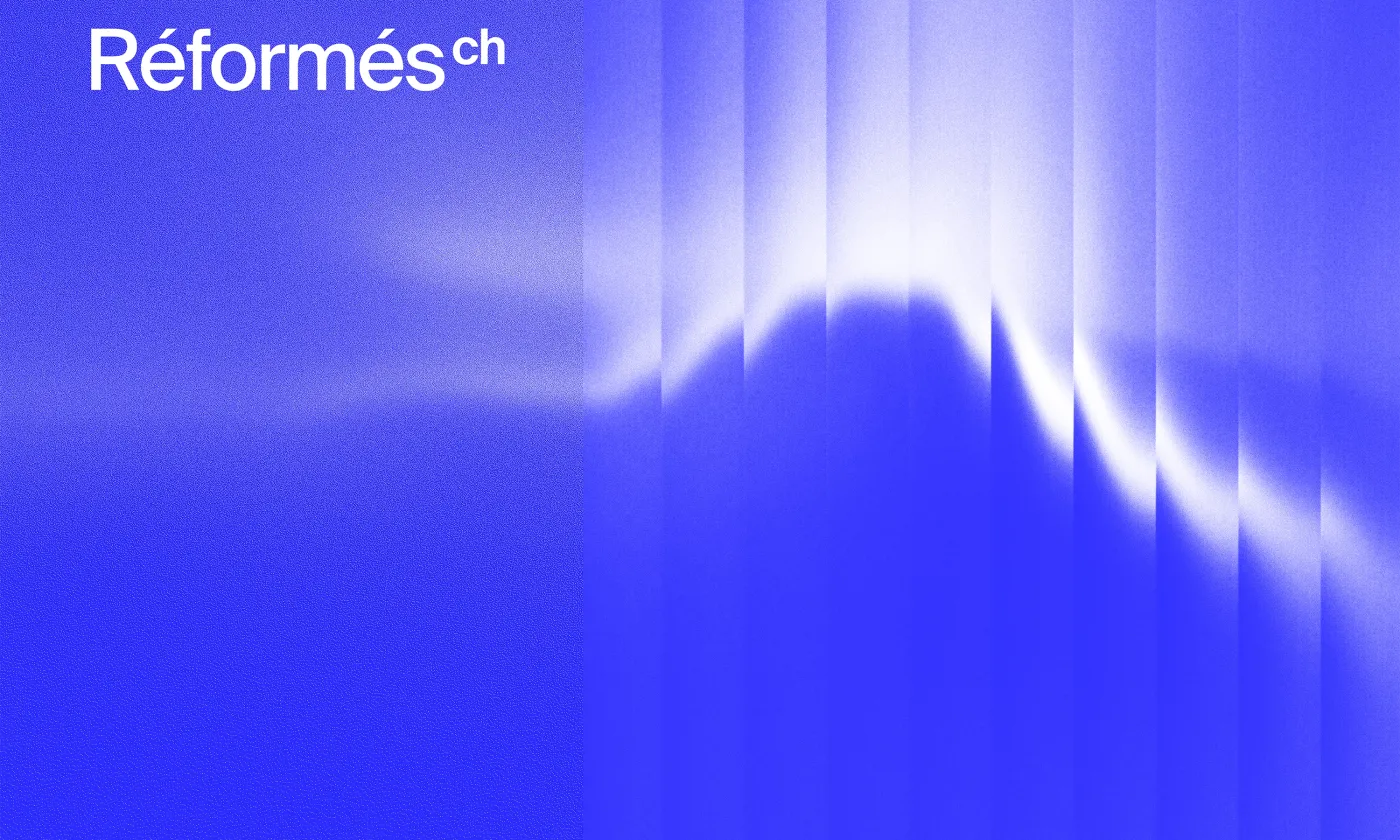
i
[pas de légende]
A Cannes, les Églises font leur cinéma
Comme beaucoup d'autres festivals de cinéma, le Festival de Cannes accueille un jury oecuménique
Né de l'intérêt des Églises pour le cinéma, il se veut porteur d'un regard singulier sur les films en compétition. Présidé pour la première fois par un cinéaste de religion juive, ce jury compte également cette année un théologien vaudois.Un pasteur sur la Croisette. Ce n'est pas le titre d'un film, mais l'expérience de Serge Molla, théologien de l'Église évangélique réformée vaudoise (EERV). « C'est la première fois que je viens à Cannes participer à ce jury », explique l'intéressé, non sans une pointe de fierté dans la voix. « Je trouve intéressant de pouvoir porter un regard différent sur le cinéma », poursuit-il.
Comme ses pairs, ce jury a pour tâche de distinguer un film de la compétition officielle. Et si son choix dépend évidemment des personnalités qui le composent, il se doit d'observer certains principes, définis par les organisateurs, SIGNIS et INTERFILM (voir plus bas).
« Nous avons un petit guide qui rappelle les 6 critères que le jury doit respecter », indique Serge Molla. Pour être primé, un film doit ainsi d'abord être « de grande qualité artistique ». Il doit aussi refléter le message de l'Évangile.
« Il ne s'agit pas de primer des films chrétiens, précise-t-il. Et nous ne nous intéressons pas aux croyances du cinéaste. Il faut que le film ait une dimension humaine, qu'il parle de valeurs transcendantes de la vie », comme par exemple la justice, la vérité, la beauté, l'amour ou le pardon.
Dans le même esprit, il faut encore que le film touche aux questions de la responsabilité, qu'il interroge les questions de la dignité et de la solidarité. Enfin, il faut qu'il ait une dimension universelle, qu'il soit créatif et qu'il puisse être diffusé, c'est-à-dire vendu à des distributeurs.
C'est selon ces considérations que le jury œcuménique de Cannes a primé Adoration d'Atom Egoyan en 2008, De l'autre côté de Fatih Akin en 2007 ou Babel de Alejandro González Inárritu en 2006. A quoi bon un prix œcuménique ?« Par principe, un jury, quel qu'il soit, est intéressant pour un festival », répond Frédéric Maire, directeur artistique du Festival international de Locarno et futur directeur de la Cinémathèque suisse. Locarno fut d'ailleurs le premier festival à accueillir un jury œcuménique dès 1973. « Tout prix aide à donner de la visibilité aux films », ajoute Frédéric Maire.
« J'ai toujours plaisir à découvrir le choix du jury œcuménique à Locarno, dont le point de vue s'intéresse plus au contenu qu'à la forme, poursuit-il. Et cela reflète aussi une partie de la perception que le public peut avoir sur le cinéma. »
Et les Églises se sont intéressées très tôt à la capacité de la toile de porter un message. Elles étaient bien sûr conscientes de l'utilité du cinéma pour la diffusion du message évangélique. Mais elles ont aussi cédé à la censure, craignant de voir cette force de communication au service de courants de pensées plus libéraux.
« En 1903, une publication catholique de cinéma se nomme Le fascinateur, exprimant bien à la fois la séduction et la crainte qu'inspire déjà la production cinématographique », indique la pasteur Denyse Muller, vice-présidente d'INTERFILM. Malgré tout, les Églises semblent avoir rendu service au septième art.
« L'Église catholique en particulier a joué un rôle important dans la diffusion du cinéma, notamment dans les oratoires en Italie », explique Frédéric Maire. L'industrie du cinéma s'est d'ailleurs intéressé très tôt aux thématiques chrétiennes, comprenant la force de relais des Églises. Avant 1915, Pathé avait ainsi déjà produit quatre Passions de Jésus.
« Les Églises protestantes ont manifesté plus tardivement leur intérêt, note Denyse Muller. En France, dans les années 1950, elles constatent que le cinéma attire plus de monde que les églises et créent alors des rencontres et débats dans les salles de cinéma ou de paroisses autour de films grand public. »SIGNIS et INTERFILMPour coordonner leur travail, les Églises catholiques crée chacune un organisme international. L'Organisation catholique international de cinéma (OCIC) voit le jour en 1928, et devient SIGNIS en 2001 (Association catholique mondiale pour la communication). INTERFILM, Organisation protestante du cinéma est quant à elle fondée en 1955 à Paris.
Ces deux organismes ont pour tâche d'informer, de créer des liens entre les Églises et le cinéma. Organisant des séminaires de réflexion et dialoguant avec des professionnels, ils se voient invités par les responsables de certains festivals à créer des jurys.
D'abord confessionnels, ces jurys dépassent ensuite l'esprit de clocher pour devenir œcuméniques. Après Locarno en 1973, le mouvement de regroupement des jurys catholiques et protestants sera imité à Cannes l'année suivante, l'OCIC y étant présente depuis 1954. Le Festival de Berlin a pour sa part conservé deux jurys confessionnels jusqu'en 1991.
Aujourd'hui, il existe environ 13 jurys œcuméniques dans autant de festivals, remettant à peu près 22 prix et mentions différents. La composition de chaque jury est proposée à part égale par INTERFILM et SIGNIS, garantissant un équilibre confessionnel, même si « on ne demande pas de certificat de baptème », précise Pierre Vaccaro, porte-parole du jury œcuménique de Cannes.
Mais pour son 35ème anniversaire, le Jury œcuménique a choisi l'originalité en nommant un président de religion juive – une première – en la personne de Radu Mihaileanu, réalisateur de Va, vis et deviens. Les organisateurs présentent ce choix comme une « preuve d’ouverture et de dialogue dans un lieu de croisement culturel comme Cannes ».
Comme ses pairs, ce jury a pour tâche de distinguer un film de la compétition officielle. Et si son choix dépend évidemment des personnalités qui le composent, il se doit d'observer certains principes, définis par les organisateurs, SIGNIS et INTERFILM (voir plus bas).
« Nous avons un petit guide qui rappelle les 6 critères que le jury doit respecter », indique Serge Molla. Pour être primé, un film doit ainsi d'abord être « de grande qualité artistique ». Il doit aussi refléter le message de l'Évangile.
« Il ne s'agit pas de primer des films chrétiens, précise-t-il. Et nous ne nous intéressons pas aux croyances du cinéaste. Il faut que le film ait une dimension humaine, qu'il parle de valeurs transcendantes de la vie », comme par exemple la justice, la vérité, la beauté, l'amour ou le pardon.
Dans le même esprit, il faut encore que le film touche aux questions de la responsabilité, qu'il interroge les questions de la dignité et de la solidarité. Enfin, il faut qu'il ait une dimension universelle, qu'il soit créatif et qu'il puisse être diffusé, c'est-à-dire vendu à des distributeurs.
C'est selon ces considérations que le jury œcuménique de Cannes a primé Adoration d'Atom Egoyan en 2008, De l'autre côté de Fatih Akin en 2007 ou Babel de Alejandro González Inárritu en 2006. A quoi bon un prix œcuménique ?« Par principe, un jury, quel qu'il soit, est intéressant pour un festival », répond Frédéric Maire, directeur artistique du Festival international de Locarno et futur directeur de la Cinémathèque suisse. Locarno fut d'ailleurs le premier festival à accueillir un jury œcuménique dès 1973. « Tout prix aide à donner de la visibilité aux films », ajoute Frédéric Maire.
« J'ai toujours plaisir à découvrir le choix du jury œcuménique à Locarno, dont le point de vue s'intéresse plus au contenu qu'à la forme, poursuit-il. Et cela reflète aussi une partie de la perception que le public peut avoir sur le cinéma. »
Et les Églises se sont intéressées très tôt à la capacité de la toile de porter un message. Elles étaient bien sûr conscientes de l'utilité du cinéma pour la diffusion du message évangélique. Mais elles ont aussi cédé à la censure, craignant de voir cette force de communication au service de courants de pensées plus libéraux.
« En 1903, une publication catholique de cinéma se nomme Le fascinateur, exprimant bien à la fois la séduction et la crainte qu'inspire déjà la production cinématographique », indique la pasteur Denyse Muller, vice-présidente d'INTERFILM. Malgré tout, les Églises semblent avoir rendu service au septième art.
« L'Église catholique en particulier a joué un rôle important dans la diffusion du cinéma, notamment dans les oratoires en Italie », explique Frédéric Maire. L'industrie du cinéma s'est d'ailleurs intéressé très tôt aux thématiques chrétiennes, comprenant la force de relais des Églises. Avant 1915, Pathé avait ainsi déjà produit quatre Passions de Jésus.
« Les Églises protestantes ont manifesté plus tardivement leur intérêt, note Denyse Muller. En France, dans les années 1950, elles constatent que le cinéma attire plus de monde que les églises et créent alors des rencontres et débats dans les salles de cinéma ou de paroisses autour de films grand public. »SIGNIS et INTERFILMPour coordonner leur travail, les Églises catholiques crée chacune un organisme international. L'Organisation catholique international de cinéma (OCIC) voit le jour en 1928, et devient SIGNIS en 2001 (Association catholique mondiale pour la communication). INTERFILM, Organisation protestante du cinéma est quant à elle fondée en 1955 à Paris.
Ces deux organismes ont pour tâche d'informer, de créer des liens entre les Églises et le cinéma. Organisant des séminaires de réflexion et dialoguant avec des professionnels, ils se voient invités par les responsables de certains festivals à créer des jurys.
D'abord confessionnels, ces jurys dépassent ensuite l'esprit de clocher pour devenir œcuméniques. Après Locarno en 1973, le mouvement de regroupement des jurys catholiques et protestants sera imité à Cannes l'année suivante, l'OCIC y étant présente depuis 1954. Le Festival de Berlin a pour sa part conservé deux jurys confessionnels jusqu'en 1991.
Aujourd'hui, il existe environ 13 jurys œcuméniques dans autant de festivals, remettant à peu près 22 prix et mentions différents. La composition de chaque jury est proposée à part égale par INTERFILM et SIGNIS, garantissant un équilibre confessionnel, même si « on ne demande pas de certificat de baptème », précise Pierre Vaccaro, porte-parole du jury œcuménique de Cannes.
Mais pour son 35ème anniversaire, le Jury œcuménique a choisi l'originalité en nommant un président de religion juive – une première – en la personne de Radu Mihaileanu, réalisateur de Va, vis et deviens. Les organisateurs présentent ce choix comme une « preuve d’ouverture et de dialogue dans un lieu de croisement culturel comme Cannes ».











