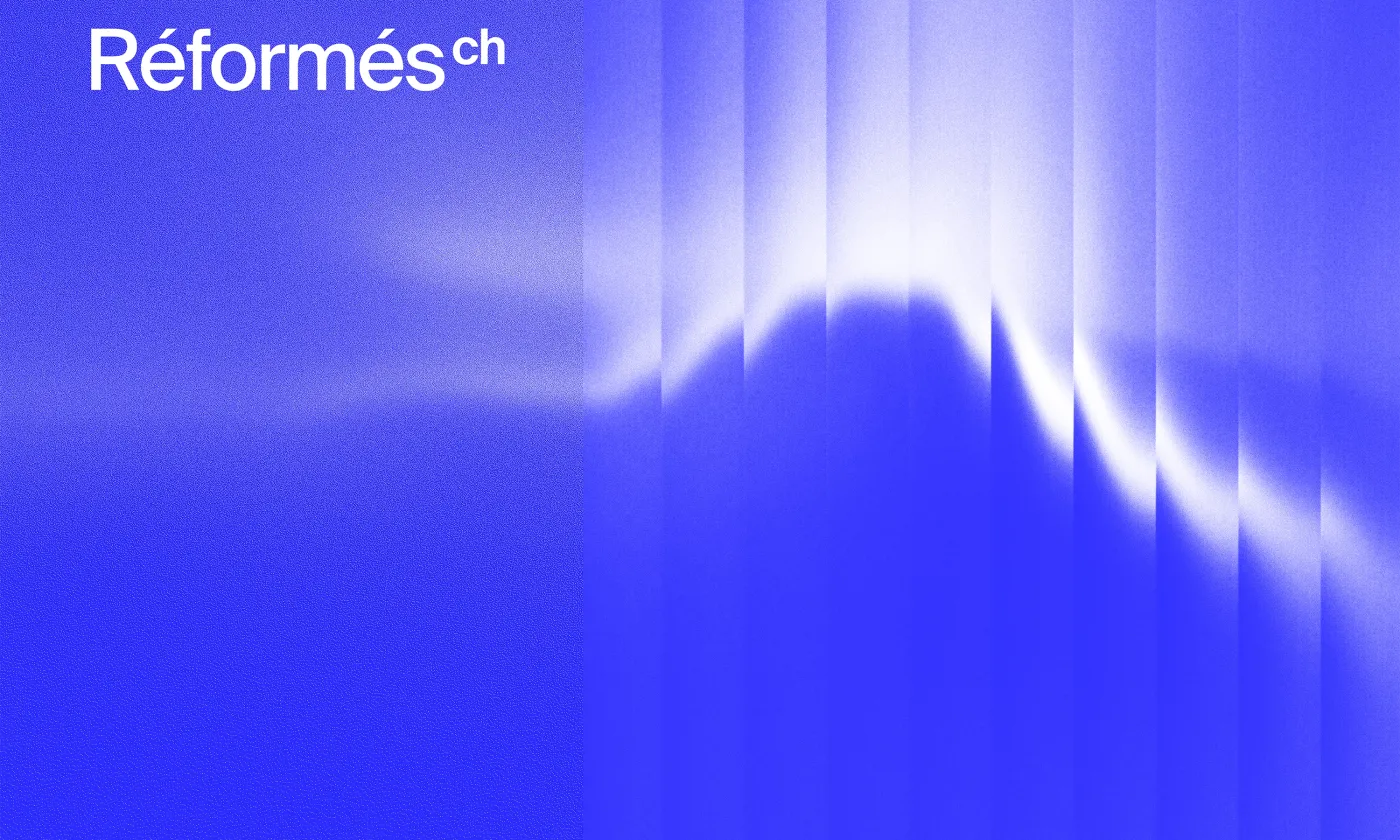
i
[pas de légende]
L’univers mouvant des associations musulmanes en Suisse
Le monde musulman suisse est de plus en plus structuré par des associations
Certaines sont très changeantes au gré d’ambitions locales. D’autres sont au contraire sous l’influence de pays lointains qui les « patronnent » et dont les conflits internes se transposent en Suisse. C’est ce que révèle la chercheuse de l’Université de Lausanne Sophie Nedjar, qui travaille sur les mobilisations musulmanes en Suisse dans un projet de thèse de doctorat .
Ces observations traduisent une immigration musulmane spécifique à la Suisse. En effet, parmi la communauté islamique du pays, la forte présence de ressortissants des Balkans s'impose.
Sur plus de 310 000 musulmans recensés en 2000, plus de la moitié sont originaires de cette région et près de 63 000 de Turquie. Toutes les autres terres d’émigration musulmane ne pèsent, pour chacune d’elle, qu’un très faible poids en comparaison, selon les données de Mallory Schneuwly Purdie dans une thèse soutenue en 2006 à Lausanne.
A noter encore 36 500 musulmans d’origine suisse, qui comptent dans leurs rangs des descendants d’immigrés naturalisés et des convertis. Ceci compose une population dont les femmes représentent 45%, où plus de 50% des individus ont moins de 25 ans et où 67% sont en âge de travailler.Les influences du lointain paysTout cet univers s’est lentement structuré au fil des vagues d’immigration et parfois sous l’ombre portée d’organisations du pays d’origine. Ainsi le Centre Culturel Islamique de Genève, créé en 1961, était dans une certaine proximité des Frères musulmans du Caire et la Grande Mosquée de Genève, datant de 1978, proche de l’Arabie Saoudite.
Mais ce qu’observe l’étude en cours menée par Sophie Nedjar sur les deux cantons de Bâle, du Tessin et de Genève, c’est comment les diverses communautés musulmanes ont spécifiquement composé avec la société helvétique.
Ainsi l’auteur relève que des associations de jeunes se sont parfois constituées « en réaction à un discours dévalorisant sur l’islam depuis le 11 septembre 2001 ». Des associations féminines, lancées par des converties d’origine suisse possédant un bon bagage culturel, se sont de la même manière parfois construites « contre les hommes », transposition de préoccupations et d’attitudes occidentales.
Quant aux influences extérieures, elles peuvent se faire sentir par exemple chez des musulmans d’origine turque par des divisions qui font écho à des problèmes dans leur pays. Mais si, dans cette communauté particulière, cela se sent beaucoup en Suisse alémanique, c’est beaucoup moins vrai au Tessin et pas du tout à Genève. L’adoption de pratiques suissesOn est assez tenté de voir dans ces premières observations de la chercheuse lausannoise une influence de la société civile helvétique où des associations naissent dans tous les domaines.
Ainsi, l’apparition d’associations qui ont des sympathies laïques comme le Forum pour un islam progressiste créé en 2004 à Zurich, l’Association des musulmans pour la laïcité apparue à Genève en 2006, ou enfin tout récemment, une réunion des musulmans ayant abandonné l’Islam, doit sans doute beaucoup à la société dans laquelle baignent leurs membres.
Ce monde associatif est encore assez instable. La multiplicité des associations ne doit du reste pas faire illusion. Certaines sont très peu actives.Un autre univers culturelIl reste que ces associations ont pour but de faciliter l’intégration de ressortissants qui sont face à d’importantes difficultés culturelles. Les musulmans découvrent en Suisse une situation de minoritaires, face à une majorité de chrétiens, pour eux tout à fait inédite. Ils sont également en présence de musulmans d’autres régions du monde et avec d’autres pratiques, ce qu’ils n’auraient que très rarement pu voir sur la terre de leurs ancêtres respectifs.
A la différence des chrétiens qu’ils côtoient, « ils revendiquent à la fois leur croyance et la force de leurs convictions », estime Mallory Schneuwly Purdie. Pour eux, leur religion n’est pas une vague origine culturelle. C’est à la fois une volonté de se rattacher à une tradition dans un lieu où ils manquent de point d’attaches et la prise en compte qu’à tout instant ils sont identifiés par les autres comme musulman. D’où, dans les pratiques religieuses, une certaine tendance à être exclusif et à « la littéralité et à l’intégralité dans l’appréhension de leurs sources religieuses ».
Ainsi si l’activisme associatif des populations musulmanes en Suisse suggère un emprunt aux manières de faire helvétique, il s’applique à des femmes et des hommes qui peinent à se trouver une identité.
Ces observations traduisent une immigration musulmane spécifique à la Suisse. En effet, parmi la communauté islamique du pays, la forte présence de ressortissants des Balkans s'impose.
Sur plus de 310 000 musulmans recensés en 2000, plus de la moitié sont originaires de cette région et près de 63 000 de Turquie. Toutes les autres terres d’émigration musulmane ne pèsent, pour chacune d’elle, qu’un très faible poids en comparaison, selon les données de Mallory Schneuwly Purdie dans une thèse soutenue en 2006 à Lausanne.
A noter encore 36 500 musulmans d’origine suisse, qui comptent dans leurs rangs des descendants d’immigrés naturalisés et des convertis. Ceci compose une population dont les femmes représentent 45%, où plus de 50% des individus ont moins de 25 ans et où 67% sont en âge de travailler.Les influences du lointain paysTout cet univers s’est lentement structuré au fil des vagues d’immigration et parfois sous l’ombre portée d’organisations du pays d’origine. Ainsi le Centre Culturel Islamique de Genève, créé en 1961, était dans une certaine proximité des Frères musulmans du Caire et la Grande Mosquée de Genève, datant de 1978, proche de l’Arabie Saoudite.
Mais ce qu’observe l’étude en cours menée par Sophie Nedjar sur les deux cantons de Bâle, du Tessin et de Genève, c’est comment les diverses communautés musulmanes ont spécifiquement composé avec la société helvétique.
Ainsi l’auteur relève que des associations de jeunes se sont parfois constituées « en réaction à un discours dévalorisant sur l’islam depuis le 11 septembre 2001 ». Des associations féminines, lancées par des converties d’origine suisse possédant un bon bagage culturel, se sont de la même manière parfois construites « contre les hommes », transposition de préoccupations et d’attitudes occidentales.
Quant aux influences extérieures, elles peuvent se faire sentir par exemple chez des musulmans d’origine turque par des divisions qui font écho à des problèmes dans leur pays. Mais si, dans cette communauté particulière, cela se sent beaucoup en Suisse alémanique, c’est beaucoup moins vrai au Tessin et pas du tout à Genève. L’adoption de pratiques suissesOn est assez tenté de voir dans ces premières observations de la chercheuse lausannoise une influence de la société civile helvétique où des associations naissent dans tous les domaines.
Ainsi, l’apparition d’associations qui ont des sympathies laïques comme le Forum pour un islam progressiste créé en 2004 à Zurich, l’Association des musulmans pour la laïcité apparue à Genève en 2006, ou enfin tout récemment, une réunion des musulmans ayant abandonné l’Islam, doit sans doute beaucoup à la société dans laquelle baignent leurs membres.
Ce monde associatif est encore assez instable. La multiplicité des associations ne doit du reste pas faire illusion. Certaines sont très peu actives.Un autre univers culturelIl reste que ces associations ont pour but de faciliter l’intégration de ressortissants qui sont face à d’importantes difficultés culturelles. Les musulmans découvrent en Suisse une situation de minoritaires, face à une majorité de chrétiens, pour eux tout à fait inédite. Ils sont également en présence de musulmans d’autres régions du monde et avec d’autres pratiques, ce qu’ils n’auraient que très rarement pu voir sur la terre de leurs ancêtres respectifs.
A la différence des chrétiens qu’ils côtoient, « ils revendiquent à la fois leur croyance et la force de leurs convictions », estime Mallory Schneuwly Purdie. Pour eux, leur religion n’est pas une vague origine culturelle. C’est à la fois une volonté de se rattacher à une tradition dans un lieu où ils manquent de point d’attaches et la prise en compte qu’à tout instant ils sont identifiés par les autres comme musulman. D’où, dans les pratiques religieuses, une certaine tendance à être exclusif et à « la littéralité et à l’intégralité dans l’appréhension de leurs sources religieuses ».
Ainsi si l’activisme associatif des populations musulmanes en Suisse suggère un emprunt aux manières de faire helvétique, il s’applique à des femmes et des hommes qui peinent à se trouver une identité.











