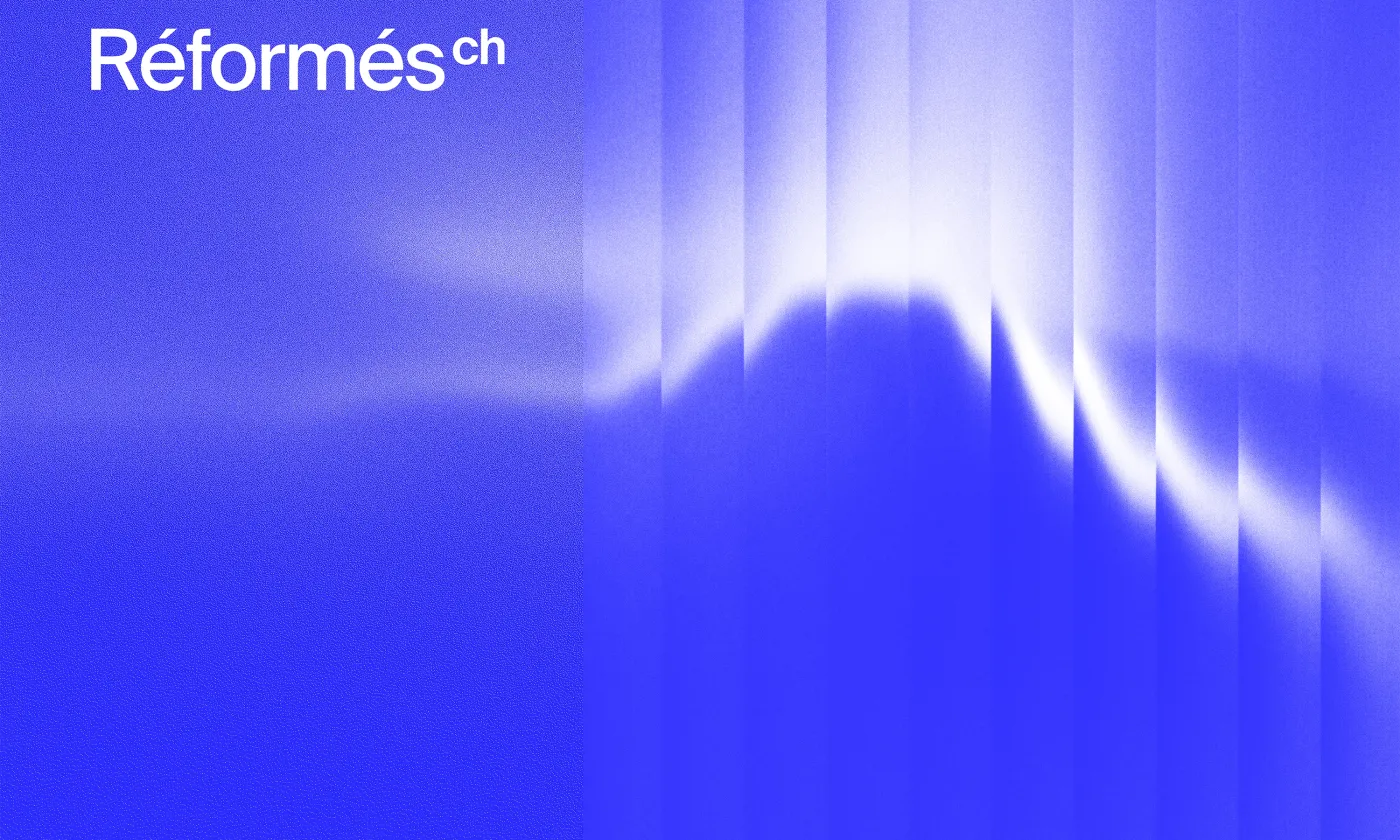
i
[pas de légende]
Entrer et sortir de l'Église, une crise ambiguë
Certaines Églises réformées de Suisse enregistrent une hausse de nouveaux membres, alors que d'autres voient se réduire les sorties d'Église
Être ou ne pas être membre se révèle d'ailleurs une question délicate, particulièrement à l'heure de payer ses impôts en période de crise économique.Certaines Églises ont du mal à ne pas pavoiser devant les résultats étonnamment bons enregistrés ces dernières années. C'est le cas en Argovie, où l'Église protestante, minoritaire à 37% environ, voit augmenter le nombre d’entrées depuis le début des années 1990.
Les derniers chiffres en date indiquent 281 membres de plus en 2007, soit une progression de plus de 170% par rapport aux 50 dernières années. Le nombre de sorties augmente toutefois lui aussi constamment sur la même période, il est actuellement environ 7 fois plus élevé que le nombre d'entrées.
D'autres Églises enregistrent des chiffres encourageants tant pour les entrées que pour les sorties. À Bâle-Campagne, majoritairement protestante, l'Église réformée voit globalement les entrées augmenter depuis les années 1980, alors que les sorties d'Église sont relativement stables depuis 10 ans (autour de 690 sorties par année).
L'Église voisine du canton de Bâle-Ville voit aussi une baisse de la perte de ses membres. « Ce n'est pas tout à fait une augmentation des entrées », remarque toutefois Roger Thiriet, porte-parole de l'Église réformée du canton de Bâle-Ville. « C'est surtout un ralentissement des sorties », a-t-il précisé à Protestinfo.
De fait, l'Église de Bâle-Ville compte 95 entrées en 2008, soit en deçà de la moyenne annuelle de ces 25 dernières années (131). La baisse des sorties s'est amorcée quant à elle au début des années 2000, la perte des membres a baissé de 38% sur les 4 dernières années, elle est à son plus bas niveau depuis 25 ans (- 734 membres).
Roger Thiriet voit deux raisons principales à cette évolution. « Premièrement, l'émigration des Bâlois a ralenti quelque peu. La plupart des membres perdus entre 1960 et 2000 sont dus à des déménagements », estime-t-il.
Deuxièmement, la campagne de communication Credo 08 de l'Église réformée a peut-être aidé à revaloriser l'image de l'Église auprès des Bâlois. « Nous sommes entrés dans la conscience publique comme une Église qui rend service », relève Roger Thiriet.
Roger Husistein de l'Institut suisse de sociologie pastorale à St-Gall (SPI) reste cependant prudent devant ces chiffres. « Peut-être que les entrées augmentent ces dernières années dans certaines Églises, mais cela reste très bas », précise-t-il.Les Églises continuent de maigrirIl est vrai que cela ne compense pas la baisse continue du nombre de fidèles. De manière générale, les sorties d'Église sont en augmentation en Suisse depuis de nombreuses années. Le mouvement de recul des Églises catholiques et réformées s'est même accentué entre 1970 et 2000, selon une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée en 2004.
Les indications de l'OFS sont toutefois à différencier de celles des Églises qui tiennent des statistiques de leurs membres. Et là encore, les méthodes changent selon les régimes cantonaux qui lient Églises et État.
Dans les cantons où les Églises sont officiellement liées à l'État, les citoyens qui souhaitent s'affranchir de l'institution religieuse doivent en effet signer une déclaration de sortie d'Église. Cette situation concerne la plupart des cantons suisses, majorité où l'impôt ecclésiastique est obligatoire.
Dans plusieurs d’entre eux, le fait même de payer sa contribution définit l’appartenance ou non à l’institution ecclésiale. À Bâle par exemple, un contribuable qui ne s'acquitte pas de son dû s'exclut de facto de l'Église et se prive de ses services.
Par contre, dans les cantons qui connaissent un régime de laïcité, tel Genève et Neuchâtel, l'appartenance à telle ou telle institution religieuse ne s'établit pas de la même manière. « Pour évaluer le nombre de nos membres potentiels, nous croisons les données de la police des habitants et celles des déclarations fiscales, sur lesquelles les citoyens déclarent leur identité confessionnelle », explique Ludovic Geiser, secrétaire général de l'Église réformée évangélique neuchâteloise (EREN).Pourquoi entrer, pourquoi sortir ?Trouver des raisons claires à ces évolutions reste de la gageure, et les sociologues et autres statisticiens optent pour la prudence. Des enjeux économiques, sociaux, et politiques peuvent entrer en ligne de compte.
La migration semble être un critère important. « Les migrants veulent généralement une Église plus traditionnelle, plus stable », relève Christiane Faschon, secrétaire générale de la Communauté de travail des Église chrétiennes en Suisse (CTEC).
Si cela se vérifie surtout auprès des communautés catholiques, c'est aussi vrai pour les Églises protestantes. « À Bâle, nous avons beaucoup d'Allemands qui viennent travailler, relève Roger Thiriet. De tradition luthérienne, ils intègrent pour une large part les communautés réformées locales. »
La dimension familiale jouerait également un rôle. « Certaines personnes ont quitté l'Église et y reviennent une fois qu'elles fondent une famille, indique Roger Husistein. Elles font ce choix par rapport à l'éducation religieuse de leurs enfants ».Rôle de la crise et des levées d'excommunicationQuant à la crise économique et sociale actuelle, difficile de savoir exactement le rôle qu'elle joue. « En temps de crise, la religion redevient attractive, indique Christiane Faschon. Nous observons généralement un regain d'intérêt pour les questions religieuses et spirituelles. L'Église représente alors un point de sécurité familial. »
A l'inverse, le besoin de faire des économies devant ces difficultés économiques incitent à couper rapidement du côté de la contribution ecclésiastique. « C'est vrai, c'est vraisemblablement la deuxième motivation à quitter l'Église », reconnaît Roger Thiriet.
Mais les Églises restent prudentes devant cet élément, et elles s'abstiennent actuellement de tirer des plans sur la comète. « Les bordereaux d'impôts viennent d'être transmis aux contribuables, nous verrons bien comment ceux-ci réagiront envers l'Église », indique M.Thiriet.
Les Églises tentent pourtant de prendre les devants sur cette question sensible, brisant le tabou de l'argent. À Neuchâtel, où l'Église est soucieuse de voir la contribution ecclésiastique se réduire d'année en année, l'EREN a ainsi entrepris une démarche originale d'« accompagnement des contribuables ».
« L'enjeu est d’améliorer le contact avec les contributeurs », indique Ludovic Geiser. Ceci devrait permettre de conserver l’adhésion à l’institution et de stabiliser les rentrées financières. Cela s'inscrit à la suite de démarches ciblées et de campagnes de communication précédentes.
« Nous avons constaté que le nombre de payements complets de la contribution ecclésiastique a augmenté pour l’EREN, remarque Ludovic Geiser. Ce sont des personnes qui payaient autrefois partiellement et qui payent aujourd’hui l’entier de leur contribution. »
Dans les cantons où l'impôt ecclésiastique est obligatoire, l'inquiétude est aussi vive pour les Églises. Elles avaient craint un accroissement massif de sorties après un arrêt du Tribunal fédéral (TF) en novembre 2007.
Le TF revenait sur une décision précédente de 2002 et reconnaissait désormais le droit à une Lucernoise de ne pas payer l'impôt en question, tout en ayant toujours accès aux services de l'Église et ses sacrements. Il semble toutefois que les conséquences soient restées minimes, l'effet de masse craint n'est pas survenu.Des spécificités catholiquesSi l'Église catholique vit globalement les mêmes difficultés en Suisse que les réformés, deux éléments supplémentaires interviennent. Elle a ressenti d'une part moins durement la baisse du nombre de fidèles à cause de l'immigration catholique de ces 50 dernières années. D'autre part, et à l'inverse, elle est plus fragile devant les polémiques autour de l'autorité catholique romaine.
Chaque décision controversée du Vatican crée en effet des remous et des vagues de plus ou moins importantes de sorties d'Église. La levée des excommunications des évêques de la Fraternité Saint-Pie X en est le dernier exemple de taille.
Les derniers chiffres en date indiquent 281 membres de plus en 2007, soit une progression de plus de 170% par rapport aux 50 dernières années. Le nombre de sorties augmente toutefois lui aussi constamment sur la même période, il est actuellement environ 7 fois plus élevé que le nombre d'entrées.
D'autres Églises enregistrent des chiffres encourageants tant pour les entrées que pour les sorties. À Bâle-Campagne, majoritairement protestante, l'Église réformée voit globalement les entrées augmenter depuis les années 1980, alors que les sorties d'Église sont relativement stables depuis 10 ans (autour de 690 sorties par année).
L'Église voisine du canton de Bâle-Ville voit aussi une baisse de la perte de ses membres. « Ce n'est pas tout à fait une augmentation des entrées », remarque toutefois Roger Thiriet, porte-parole de l'Église réformée du canton de Bâle-Ville. « C'est surtout un ralentissement des sorties », a-t-il précisé à Protestinfo.
De fait, l'Église de Bâle-Ville compte 95 entrées en 2008, soit en deçà de la moyenne annuelle de ces 25 dernières années (131). La baisse des sorties s'est amorcée quant à elle au début des années 2000, la perte des membres a baissé de 38% sur les 4 dernières années, elle est à son plus bas niveau depuis 25 ans (- 734 membres).
Roger Thiriet voit deux raisons principales à cette évolution. « Premièrement, l'émigration des Bâlois a ralenti quelque peu. La plupart des membres perdus entre 1960 et 2000 sont dus à des déménagements », estime-t-il.
Deuxièmement, la campagne de communication Credo 08 de l'Église réformée a peut-être aidé à revaloriser l'image de l'Église auprès des Bâlois. « Nous sommes entrés dans la conscience publique comme une Église qui rend service », relève Roger Thiriet.
Roger Husistein de l'Institut suisse de sociologie pastorale à St-Gall (SPI) reste cependant prudent devant ces chiffres. « Peut-être que les entrées augmentent ces dernières années dans certaines Églises, mais cela reste très bas », précise-t-il.Les Églises continuent de maigrirIl est vrai que cela ne compense pas la baisse continue du nombre de fidèles. De manière générale, les sorties d'Église sont en augmentation en Suisse depuis de nombreuses années. Le mouvement de recul des Églises catholiques et réformées s'est même accentué entre 1970 et 2000, selon une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée en 2004.
Les indications de l'OFS sont toutefois à différencier de celles des Églises qui tiennent des statistiques de leurs membres. Et là encore, les méthodes changent selon les régimes cantonaux qui lient Églises et État.
Dans les cantons où les Églises sont officiellement liées à l'État, les citoyens qui souhaitent s'affranchir de l'institution religieuse doivent en effet signer une déclaration de sortie d'Église. Cette situation concerne la plupart des cantons suisses, majorité où l'impôt ecclésiastique est obligatoire.
Dans plusieurs d’entre eux, le fait même de payer sa contribution définit l’appartenance ou non à l’institution ecclésiale. À Bâle par exemple, un contribuable qui ne s'acquitte pas de son dû s'exclut de facto de l'Église et se prive de ses services.
Par contre, dans les cantons qui connaissent un régime de laïcité, tel Genève et Neuchâtel, l'appartenance à telle ou telle institution religieuse ne s'établit pas de la même manière. « Pour évaluer le nombre de nos membres potentiels, nous croisons les données de la police des habitants et celles des déclarations fiscales, sur lesquelles les citoyens déclarent leur identité confessionnelle », explique Ludovic Geiser, secrétaire général de l'Église réformée évangélique neuchâteloise (EREN).Pourquoi entrer, pourquoi sortir ?Trouver des raisons claires à ces évolutions reste de la gageure, et les sociologues et autres statisticiens optent pour la prudence. Des enjeux économiques, sociaux, et politiques peuvent entrer en ligne de compte.
La migration semble être un critère important. « Les migrants veulent généralement une Église plus traditionnelle, plus stable », relève Christiane Faschon, secrétaire générale de la Communauté de travail des Église chrétiennes en Suisse (CTEC).
Si cela se vérifie surtout auprès des communautés catholiques, c'est aussi vrai pour les Églises protestantes. « À Bâle, nous avons beaucoup d'Allemands qui viennent travailler, relève Roger Thiriet. De tradition luthérienne, ils intègrent pour une large part les communautés réformées locales. »
La dimension familiale jouerait également un rôle. « Certaines personnes ont quitté l'Église et y reviennent une fois qu'elles fondent une famille, indique Roger Husistein. Elles font ce choix par rapport à l'éducation religieuse de leurs enfants ».Rôle de la crise et des levées d'excommunicationQuant à la crise économique et sociale actuelle, difficile de savoir exactement le rôle qu'elle joue. « En temps de crise, la religion redevient attractive, indique Christiane Faschon. Nous observons généralement un regain d'intérêt pour les questions religieuses et spirituelles. L'Église représente alors un point de sécurité familial. »
A l'inverse, le besoin de faire des économies devant ces difficultés économiques incitent à couper rapidement du côté de la contribution ecclésiastique. « C'est vrai, c'est vraisemblablement la deuxième motivation à quitter l'Église », reconnaît Roger Thiriet.
Mais les Églises restent prudentes devant cet élément, et elles s'abstiennent actuellement de tirer des plans sur la comète. « Les bordereaux d'impôts viennent d'être transmis aux contribuables, nous verrons bien comment ceux-ci réagiront envers l'Église », indique M.Thiriet.
Les Églises tentent pourtant de prendre les devants sur cette question sensible, brisant le tabou de l'argent. À Neuchâtel, où l'Église est soucieuse de voir la contribution ecclésiastique se réduire d'année en année, l'EREN a ainsi entrepris une démarche originale d'« accompagnement des contribuables ».
« L'enjeu est d’améliorer le contact avec les contributeurs », indique Ludovic Geiser. Ceci devrait permettre de conserver l’adhésion à l’institution et de stabiliser les rentrées financières. Cela s'inscrit à la suite de démarches ciblées et de campagnes de communication précédentes.
« Nous avons constaté que le nombre de payements complets de la contribution ecclésiastique a augmenté pour l’EREN, remarque Ludovic Geiser. Ce sont des personnes qui payaient autrefois partiellement et qui payent aujourd’hui l’entier de leur contribution. »
Dans les cantons où l'impôt ecclésiastique est obligatoire, l'inquiétude est aussi vive pour les Églises. Elles avaient craint un accroissement massif de sorties après un arrêt du Tribunal fédéral (TF) en novembre 2007.
Le TF revenait sur une décision précédente de 2002 et reconnaissait désormais le droit à une Lucernoise de ne pas payer l'impôt en question, tout en ayant toujours accès aux services de l'Église et ses sacrements. Il semble toutefois que les conséquences soient restées minimes, l'effet de masse craint n'est pas survenu.Des spécificités catholiquesSi l'Église catholique vit globalement les mêmes difficultés en Suisse que les réformés, deux éléments supplémentaires interviennent. Elle a ressenti d'une part moins durement la baisse du nombre de fidèles à cause de l'immigration catholique de ces 50 dernières années. D'autre part, et à l'inverse, elle est plus fragile devant les polémiques autour de l'autorité catholique romaine.
Chaque décision controversée du Vatican crée en effet des remous et des vagues de plus ou moins importantes de sorties d'Église. La levée des excommunications des évêques de la Fraternité Saint-Pie X en est le dernier exemple de taille.











