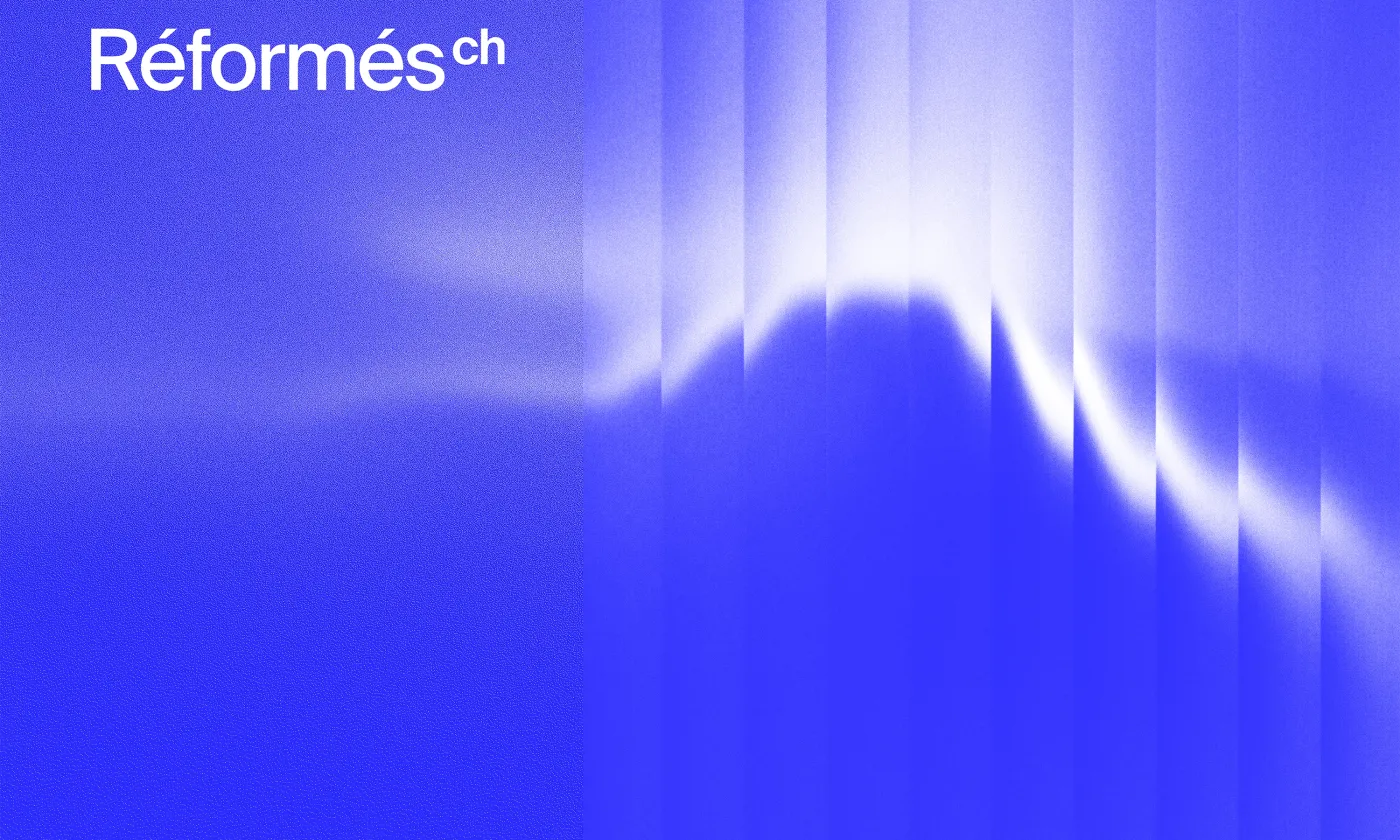
i
[pas de légende]
Calvin et l’argent vus par Jean-François Bergier
« Il est abusif de dire que Calvin a contribué à développer le capitalisme », estime le professeur Jean-François Bergier, invité par l’Uni3 de Genève à participer ce mardi 13 janvier au cycle de conférence organisé à l’occasion de l’année Calvin
Si pour le sociologue Max Weber, il ne faisait aucun doute que le calvinisme et sa doctrine de la prédestination ont été un facteur-clé dans l’essor du capitalisme, les fidèles voyant dans la réussite de leur activité professionnelle une confirmation de leur statut d’élus, Jean-François Bergier se montre plus nuancé. Interview.En quoi Calvin a-t-il bien pu émettre des recommandations concernant une économie de type capitaliste ?Calvin n’était d’aucune manière un théoricien de l’économie. Il est arrivé à une époque de croissance économique pour les élites. Ce qui n’est pas sans importance. C’est vrai qu’il a légitimé le prêt à intérêt, contraire à l’idée de l’Église romaine, mais cela n’en fait pas pour autant un « capitaliste », au sens où on l’entend aujourd’hui. Il a introduit une distinction entre le prêt à la consommation et le prêt à l’investissement. Il ne s’opposait pas au prêt accordé à un entrepreneur qui souhaite engager des ouvriers pour travailler. Il estimait qu’un intérêt, dans ces cas-là, se justifie, à condition qu’il soit raisonnable. Il recommandait la pratique, très courante au 16e siècle, du petit crédit. Les paysans devaient souvent emprunter pour faire la soudure jusqu’à la nouvelle récolte. A Genève, Calvin côtoyait des hommes d’affaires, il était sensible à leurs besoin de concilier leurs activités avec leur foi. Il préconisait une économie de la solidarité dans le cercle familial ou le voisinage. Ce qu’on appelle une économie morale ?Il proposait une économie morale et une économie du don. Pour lui, la richesse est légitime, elle est un signe de la bonne volonté de Dieu, à condition que les personnes partagent avec les pauvres. Il encourage la solidarité, les institutions de bienfaisance et appuie le rôle de l’Hospice général. Le riche est là pour aider le pauvre. Il condamnait par contre l’accaparement des richesses et la spéculation qui aggravent les conditions de vie des pauvres. Il fustigeait le commerçant ou le boulanger qui amasse des stocks de grains quand les récoltes sont abondantes et que le prix des céréales est bas, pour les revendre très cher dans les périodes de pénurie.. Mais au milieu du 16e siècle, la situation change ; on entre dans une période d’inflation et de plus grandes difficultés, le fossé se creuse entre riches et pauvres. Ce qui a modifié la perspective de Calvin. Il condamne le luxe ostentatoire, une insulte à ceux qui n’en ont pas les moyens. Pour lui, le chrétien doit mener une vie simple et pure.Lui-même avait-il de l’argent ? En tant que modérateur de la Compagnie des pasteurs, il avait un bon salaire en espècxes et en nature. Il était à l’abri des soucis matériels. Dans ses sermons, il a abordé la question des salaires. Il estimait que le salaire a pour but de permettre vivre et de faire vivre sa famille. Le salaire n’est pas lié à la quantité ni à la qualité des prestations fournies. Il est une participation du travailleur au gain de l’entreprise qui l’emploie, et qui se doit de redistribuer la richesse aux plus démunis.











